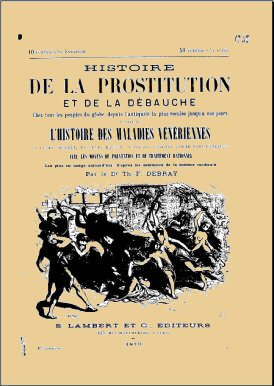Φρύνη ᾿Επικλέους Θεσπική
Phryné,
fille d'Epiclès, de Thespies

ἐς κλινάριον πόρνης ἀπὸ δάφνης
Λέκτρον ἑνὸς φεύγουσα λέκτρον πολλοῖσιν ἐτύχθεν !
Sur le lit en bois de laurier d’une
prostituée :
Moi qui ai fui la couche d’un seul, le
destin m’a faite couche de bien des hommes !
Anth. 9, 529.
Le
jeune homme le regarda :
– C’est
bien à Phryné, n’est-ce pas, dit-il, que s’appliquait cette parole de
Cratès ?
– En
effet, répondit Sarapion. Elle s’appelait Mnésarété et reçut le surnom de
Phryné [« Crapaud »] à cause de son teint jaunâtre.
Plutarque, Sur
les oracles de la Pythie, 14.
[Hypéride] était l’amant de la courtisane Phryné et fut
impliqué avec elle dans un procès en impiété. Il en convient lui-même au début
de son discours. Comme elle était sur le point d’être condamnée, il la fit
avancer au milieu de l’assemblée, déchira son vêtement et montra sa poitrine.
Elle fut acquittée parce que les juges avaient pu admirer sa beauté.
Pseudo Plutarque, Vie d'Hypéride.


M. Philippe Remacle
a traduit le passage des Deipnosophistes (XIII, 59) où Athénée nous
parle de Phryné, et m’a fait parvenir le texte grec accompagné de sa
traduction. J’en reproduis ci-dessous deux extraits. Vous trouverez le texte
intégral dans les pages que M. Remacle consacre aux courtisanes chez
Athénée.
De fait,
Phryné était plus belle dans ses parties cachées. C’est pourquoi on ne pouvait
pas facilement avoir un aperçu d'elle nue parce qu’elle portait toujours une
tunique qui enveloppait étroitement son corps et elle n’allait pas aux bains
publics. A la grande assemblée des Eleusines et au fêtes de Poséidon, à la vue
de l’ensemble du monde grec, elle enleva seulement son manteau et laissa tomber
ses longs cheveux avant d’entrer dans l'eau; elle fut le modèle pour Apelle
quand il peignit son Aphrodite sortant de la mer.
De
Phryné elle-même, les proches firent et installèrent une statue d'or à Delphes,
sur un pilier de marbre de Pentélique. C’est Praxitèle qui effectua le travail.
Quand le cynique Cratès le vit, il l’appela une cadeau consacré à
l'incontinence grecque. Cette image se trouve entre celle d'Archidamus, de roi
de Lacédémone, et de celle de Philippe, le fils d'Amyntas, et porte une
dédicace, "Phryne, fille d'Epiclès, de Thespies"; comme le dit
Alcetas dans le deuxième livre de son oeuvre sur les offrandes dédicacées à
Delphes.
Pour continuer,
voici un extrait de la savoureuse Histoire de la prostitution et de la
débauche, par le Dr TH.-F. Debray, publiée à Paris en 1879 :
|
|
On raconte, par exemple, que la belle Phryné, se trouvant à un festin
avec plusieurs courtisanes athéniennes, et jouant à un jeu dans lequel toutes
étaient obligées de faire ce que ferait l’une d’elles, trempa sa main dans un
bassin d’eau fraîche et s’en frotta par deux fois le visage, ce qui la fit
paraître plus fraîche et plus jeune encore ; – mais les autres, forcées de
faire comme elle, ne tirèrent point de ce jeu même avantage, tant s’en faut,
car elles étaient fardées. […]
Euthias, pour se venger des
dédains de la célèbre Phryné, l'accusa d'impiété, accusation qui n'entraînait
pas moins que la peine de mort.
Traduite devant le tribunal des
héliastes, la belle courtisane fut défendue avec une éloquence passionnée par
son avocat Hypéride, lequel, par exemple, gagna son procès au moyen d'un
mouvement oratoire qu'il serait difficile d'employer aujourd’hui. Au milieu de
sa péroraison, d'un mouvement rapide et imprévu, le défenseur enleva le peplos
qui couvrait sa cliente et dévoila à ses juges charmés toutes les splendeurs
secrètes de sa beauté. Ceux-ci frappés d'admiration, d'une sorte d'admiration
religieuse, car ils se rappelèrent à propos que ces formes incomparables
avaient été reproduites par Praxitèle et Apelle, et qu'on les adorait à Delphes
et ailleurs, ne voulurent point consentir à ce qu'il fût porté la main sur
cette image, ou plutôt sur ce modèle des déesses.
Phryné fut donc absoute. –
Socrate avait succombé sous une accusation pareille, mais pour le philosophe,
l'argument d'Hypéride fût resté sans force : Socrate était vieux et laid.
Cependant toutes les courtisanes triomphèrent avec Phryné, chose
étrange ! car la jalousie régnait en maîtresse parmi elles, comme de
raison. Leur enthousiasme pour Hypéride, par suite, ne connut plus de bornes,
et ce dut être un gaillard bien heureux, et peut-être fort embarrassé de
l'excès de son bonheur, pendant quelque temps.
« Grâces aux
dieux, écrivait la belle Bacchis à l'avocat de son amie, nos profits sont
légitimés par le dénouement de ce procès inique. Vous avez acquis des droits
sacrés à notre reconnaissance. Si même vous consentiez à recueillir et à
publier la harangue que avez prononcée en faveur de Phryné, nous nous
engagerions à vous ériger à nos frais une statue d'or dans l’endroit de la
grève que vous indiqueriez.
Voici au moins un talent bien récompensé. Ce que c'est
pourtant que de savoir bien employer celui qu'on possède, si mince
soit-il ! et comme c'est un art profitable que celui de savoir à qui
s'adresser !
Quant aux courtisanes de cet heureux temps, on voit
qu'elles étaient riches, puisqu'elles parlaient d'une statue d'or comme
aujourd’hui [en 1879 !] leurs pareilles pourraient parler d'un buste en
terre cuite ou d'une douzaine de cartes photographiques. Phryné, d'ailleurs, se
souvenant probablement de la fille de Chéops, avait proposé de bâtir Thèbes à
ses frais, avec cette inscription sur la porte principale : Alexandre l’a
détruite, Phryné l'a rebâtie. – Comme c'était là une condition sine qua non,
la proposition fut refusée.
L’accusateur Euthias, qu'on ne connaît guère que par ce
trait, était par contre la tête de turc (si l’on peut s'exprimer ainsi) de
toutes ces belles pécheresses, qu'il semblait qu’Hypéride eût vraiment vengées
dans Phryné, bien que rien ne justifie cette prétention. La même Bacchis
écrivait à son amie Myrrine, à propos de ce fourbe d'Euthias, qui pouvait être
malgré cela un fort honnête homme : « Essaye d'exiger quelque chose
d'Euthias en échange de ce que tu lui donneras, et tu verras s'il ne t’accuse
pas d'avoir incendié la flotte ou violé les lois fondamentales de
l'État ! »
PHRYNÉ
L’HÉTAIRE
Jean Bertheroy
1913
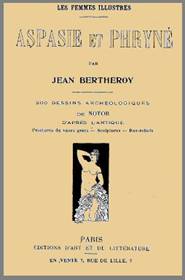
PHRYNÉ, par une sorte de prédestination singulière, naquit à
Thespies de Béotie, la ville dont l’Amour était le dieu ancien et unique. Elle était
fille d’Epicleus, comme nous l’apprend une inscription placée à la base de sa
statue, dans le temple de Delphes. C’est tout ce que nous savons de sa
naissance, et le nom de sa mère nous est inconnu. Les auteurs modernes ne
s’accordent même pas sur la date de sa venue au monde, et se contentent de nous
apprendre qu’elle vivait au quatrième siècle avant Jésus-Christ. Mais en
s’aidant des principaux synchronismes de sa vie associée à tant d’autres vies
glorieuses de la Grèce, à tant d’événements fameux que l’Histoire nous a
conservés, on peut arriver à déduire d’une façon à peu près certaine qu’elle
naquit au cours de la cent quatrième olympiade, c’est-à-dire vers l’année 360
de l’ère antique. Elle était jeune encore, mais déjà au comble de la fortune, lorsqu’elle
proposa de rebâtir à ses frais la ville de Thèbes, détruite par Alexandre en
335 - date mémorable ! Elle l’était, certainement encore lorsque
Praxitèle, dans la cent douzième olympiade, s’éprit d’elle et par son ciseau la
voua à l’immortalité.
Qu’importent, d’ailleurs, des précisions plus exactes ? C’est
surtout dans une histoire comme celle-ci, où tout est grâces, mystères,
parfums, qu’il faut se garder de ce que Renan a appelé « la déplorable
manie de la certitude ». Pour composer ce bouquet, où l’on respirera
peut-être un peu des fragrances intimes de la grande courtisane, il a fallu
glaner dans beaucoup de champs, récolter beaucoup de fleurs éparses, secouer
beaucoup de poussières...
Les parents de Phryné étaient pauvres. Toute petite, la fillette
fut envoyée au marché de Thespies et sur les routes voisines, pour vendre des
câpres. Elle dut apprendre, mêlée aux paysans qui venaient approvisionner la
ville, aux maraîchers, aux fruitiers, aux débitants d’huile et de miel, elle
dut apprendre très vite la valeur concrète de l’or et l’art de séduire
l’acheteur par le geste et par le sourire. Déjà son âme féminine, souple,
avisée, conquérante, s’exerçait aux prises difficiles et aux justes ruses, du
gain. Accompagnée de Glycère, la « bouquetière-enfant », dont
l’Anthologie nous a conservé la figure charmante, et qui plus tard devint, elle
aussi, une des grandes courtisanes de son temps, elle courait le long des
sentiers poudreux, vêtue, selon la coutume béotienne, d’une simple tunique
d’étamine, ou d’un de ces chitons à plis étroits pareils à ceux que les
artistes de Tanagre jetaient sur les corps graciles de leurs modèles. Toutes
deux, les pieds nus mais le front couronné. de fleurs nouvelles, audacieuses et
innocentes, et secrètement rivales, elles devaient déjà porter sur elles la
beauté des jeunes filles de Béotie, dont l’abbé Barthélemy, parlant d’après
Dicéarque, nous décrit ainsi les traits principaux : « Elles sont
blondes, bien faites, élégantes ; leur taille est élevée ; leur voix
est infiniment douce et sensible. » La voix de Phryné, la voix de
Glycère... Ne semble-t-il pas que nous les entendons, écho lointain, musique
errante mêlée aux bruissements des feuillages, au murmure rapide des sources, à
la grande voix harmonieuse d’Hellas...
Ainsi la petite Phryné cultiva dès l’enfance l’art de plaire. Mais
le marché de Thespies ne fut pas la seule école où elle prit des leçons. Tout,
autour d’elle, parlait de grâce, de volupté. Ce pays de sa naissance, où les
hommes étaient rudes, mais où la terre était délicieusement riante et fertile,
dut offrir à ses regards enivrés d’inoubliables tableaux. Vers le soir, quand
le soleil teignait de rouge les pentes ombreuses de l’Hélicon, l’enchantement
commençait. Les bois, les lacs, les fontaines s’animaient de la vie des
Nymphes. Tous ces contes de fée délicieux qu’étaient les mythes grecs pris dans
leur côté sensible, toutes ces histoires de métamorphoses, de charmes magiques,
de miraculeux éveils, les jeux incessants de l’Amour, ravissaient sans doute
l’imagination de la fillette. Tout près de Thespies, et non loin de l’enclos
paternel, c’était la fontaine d’Hippocrène et le bois sacré des Muses. Là,
Narcisse, tenté par sa propre beauté, avait miré dans l’étang pâle son corps
cligne d’un demi-dieu. Le nostalgique éphèbe, symbole de l’Illusion suprême,
s’était peu à peu confondu et dissous dans la substance même du monde, – il
était devenu une de ces fleurs délicates que Phryné, petite soeur des Nymphes,
pouvait respirer sur son chemin. Puis c’était encore Clyto, Ajax, Hyacinthe,
Daphné... Tous avaient, eux aussi, respiré l’Illusion suprême ; tous
s’étaient changés en fleurs, en roseaux, en voix plaintives dans la nuit. A
travers les lauriers noirs aux branches traînantes sur le sol, on pouvait
suivre la trace des Faunes charmants, aux pieds de biches, une rose au milieu
du front, poursuivant les tremblantes Dryades, qui dans l’Hélicon même avaient
pris naissance, comme les quatre Muses primitives et les deux Grâces, compagnes
terrestres de l’Amour.
Mais la religion de Thespies, malgré ces apparences souriantes,
cachait un formidable mystère. Cette ville, dont la population s’était réduite
peu à peu à celle d’un simple bourg, gardait seule peut-être, avec l’île
antique de Samothrace, le culte d’un dieu unique, éternel, considéré comme la
cause et le principe de tout, l’âme essentielle de l’Univers. Et ce dieu était
l’Amour. Dans le temple obscur où il était adoré, on le représentait, non point
tel que l’ont montré plus tard les mythologies de la décadence ;. sous l’apparence
d’un enfant blond et rose, armé d’un carquois, mais comme un jeune homme
pensif, aux traits marqués d’une tristesse infinie. Ce n’était point le fils de
Vénus ; il s’était engendré lui-même. II était le commencement et la fin,
« l’oogène » par excellence, le « Verbe fait chair, en qui
brillait la lumière du monde ». Il tenait à la main le flambeau de la vie.
Plus tard on lui mit des ailes d’or pour signifier sans doute que cette vie
qu’il accordait aux humains n’était qu’un court passage vers une destinée plus
haute. D’autres symboles lui furent adjoints. Il resta quand même, dans le
cycle divin de Thespies, le « Grand Eros », le phénomène de
l’Amour dans sa plus haute généralité, la Monade unique.
Sans doute, au quatrième siècle, ces idées antiques s’étaient
obscurcies, comme s’était obscurcie dans l’Île mystique de Samothrace l’idée de
l’Hermès primitif. Elles n’en demeuraient pas moins à l’état latent et
formaient autour du dieu de Thespies une atmosphère de vénération, de confiance
et de crainte. Les Thespiens (et ce fut la troisième période du culte d’Éros)
avaient institué en son honneur des fêtes solennelles qu’on appelait les
Érotidies ; de même que les Olympiades, elles se célébraient tous les
quatre ans, et c’était alors dans le bourg déchu l’animation des journées
sacrées. Cette Béotie, dont Athènes raillait les moeurs rustiques, montrait
alors à la Grèce les trésors incomparables qu’elle renfermait dans son
sein ; elle avait ses artistes, ses poètes, la beauté inégalée de ses
femmes et le culte du plus puissant des dieux. Corinne et Pindare étaient
sortis de ses montagnes chevelues ; les coroplastes de Tanagre, à côté de
l’art officiel qui représentait les dieux et les déesses dans leur impavide
majesté, avaient inventé l’art des figurines populaires qui fixaient les gestes
de chaque jour ; et ces formes exquises, pleines de vie, allaient consoler
les morts dans leurs tombeaux ; enfin le grand Hésiode, ce chantre
immortel, était lui-même un enfant de la Béotie. Tous ces souvenirs, toutes ces
gloires, se mêlaient aux fastes des journées d’Éros. Les joutes musicales, les
combats des athlètes enveloppaient d’une atmosphère de vie ardente les rites
secrets accomplis dans le mystère du temple. Puis, les Muses et les Charites
avaient leur part des hommages rendus à l’Amour. On allait sur l’Hélicon, à la
fontaine d’Hippocrène, aux bords fleuris du Permesse et dans le bois sacré, où
poussait l’andrachné qui rendait irrésistibles tous ceux qui la cueillaient
pendant le cycle d’Éros. De longues théories de vierges et d’éphèbes, reliées
par des guirlandes de jacinthes, suivaient les sentiers chers aux présences
divines et que les pieds des Nymphes avaient foulés. Partout il y avait des
autels, des trépieds de bronze, des stèles où s’inscrivaient des dates
mémorables ; partout frémissaient la jeunesse du dieu et la jeunesse de la
terre.
Ces
spectacles devaient exalter jusqu’au délire l’âme sensuelle de Phryné. Nul
doute que la petite marchande de câpres, jointe aux autres enfants de Thespies,
n’ait grossi le cortège qui, durant les Érotidies, se répandait dans les
campagnes et remplissait l’air sonore de chants, de cris et d’hymnes
ardents ; nul doute qu’elle n’ait lavé son visage aux oncles fraîches du
Permesse et cueilli, elle aussi, dans le bois sacré la plante enchantée qui
assurait le don de séduire. La main nouée à celle de quelque garçon timide, son
épaule frêle sortant de l’exomide étroite, elle dut franchir les rampes de
l’Hélicon, qu’embaumaient les pousses nouvelles des myrtes. Elle dut mêler sa
voix à celle des cigales bruissantes dans le soleil et des tourterelles
amoureuses dans le déclin empourpré du jour. Peut-être déjà le Grand Éros, le
dieu formidable et doux, au mélancolique sourire, avait-il en secret, comme on
marque un fruit que l’été prochain va mûrir, marqué ce corps à la pulpe acide
pour en faire l’instrument de sa puissance parmi les hommes. Phryné la
Thespienne pouvait-elle échapper à son destin ?
II
Ce fut vers sa treizième année, d’après un fragment de Callimaque
de Cyrène, que la petite Phryné quitta ses parents et les vallons obscurs de la
Béotie pour venir gagner sa vie dans l’Attique. Athènes était à ce moment le
centre brillant du monde ; après la secousse brutale des guerres Médiques,
elle avait mis près d’un siècle à réparer ses ruines ; Cimon et Périclès,
animés du même zèle pieux, avaient employé l’or des Perses à la parer de
nouveaux chefs-d’oeuvre. Une admirable pléiade d’artistes, que Phidias couvre
de son ombre puissante, mais parmi lesquels la postérité a retenu les noms de
Poeonios, d’Agoraclète, d’Ictinus, de Cléomène, de quelques autres encore,
avait posé au sommet de sa vieille Acropole des temples neufs, des dieux
rajeunis et des Victoires innombrables que dominait l’Athenaïa glorieuse à la
lance d’or ; ils avaient fait d’elle cette cité dont le nom seul éveillait
par toute la terre l’idée de la Beauté et du Génie.
Ce prestige devait agir puissamment sur l’esprit des générations de
cette époque. On allait à Athènes, comme on vient aujourd’hui à Paris, avec la
double intention de faire fortune et de jouir. Tandis que les autres villes de
la Grèce, quoique possédant aussi des trésors clignes de leur réputation
lointaine, demeuraient un peu pédantes, un peu fermées, un peu
« province » en un mot, tandis que Corinthe exigeait de ses visiteurs
des libéralités excessives, et que Sparte avait une loi qui en rendait le
séjour difficile aux étrangers, Athènes restait la cité accessible à tous, la
cité de l’art, du travail et du plaisir. Les pauvres et les riches, les fous et
les sages se nourrissaient du lait de ses mamelles puissantes, et se
repaissaient les yeux de la vue de ses merveilles. Il n’en coûtait rien pour
contempler les Propylées dans leur ruissellement de marbre, et le Parthénon
dont les colonnes calmes et pures s’alignaient sur le bleu profond du
ciel ; qu’ils eussent des cigales d’or clans les cheveux, ou dans les
mains les humbles violettes de la déesse, tous étaient égaux devant
« cette Reine de gloire, assise sur son trône de pourpre ». La joie était
dans l’air ; l’esprit courait les rues et les portiques... La ville de
Pallas était devenue le vestibule de l’Olympe, où l’on vivait dans la
conversation familière des dieux.
Aussi les étrangers y étaient-ils nombreux. Chaque année en amenait
un contingent considérable. Les vrais « Athéniens d’Athènes » étaient
trente mille tout au plus, alors que les « domiciliés » portaient sa
population au chiffre de cent vingt mille. Il est vrai que dans ce chiffre
figuraient pour un tiers, assure Xénophon, les esclaves et les prostituées. Ce
qu’il y avait de plus beau dans tout le Péloponnèse parmi les vierges et les
éphèbes était soigneusement trié, choisi et amené au port de Phalère en des
barques que des tentes mobiles protégeaient contre les ardeurs du soleil.
La petite Phryné fut-elle conduite à Athènes par un de ces
recruteurs de fruits intacts, ou s’en alla-t-elle seule par les chemins abrupts
du mont Parnès avec quelques drachmes cachées sous les plis de son
exomide ? Cette dernière hypothèse est la plus probable, car il ne paraît
pas qu’elle ait jamais eu à s’affranchir du joug d’un maître. D’ailleurs, elle
ne fit pas tout de suite argent de son corps ; elle venait exercer le
métier de joueuse de flûte, qui, s’il côtoyait de près la débauche, n’était pas
forcément un métier infâme. Les joueuses de flûte à Athènes, comme à Mytilène,
comme à Corinthe, formaient un corps à part, entretenu aux frais de
l’État ; elles participaient aux solennités publiques, aux enterrements,
aux fêtes religieuses ; – mais surtout elles figuraient dans les banquets,
dont elles étaient la grâce jeune et mouvante. La plupart savaient aussi danser
et exécuter divers tours d’adresse, si nous en croyons les Chansons de
Bilitis :
Quand la première aube
se mêla aux lueurs affaiblies des flambeaux,
je fis entrer dans
l’orgie une joueuse de flûte vicieuse et agile,
qui tremblait un peu,
ayant froid.
Louez
la petite fille aux paupières bleues,
aux
cheveux courts, aux seins aigus,
vêtue
seulement d’une ceinture,
d’où pendaient des
rubans jaunes et des tiges d’iris noirs.
Louez-la ! car
elle fut adroite et fit des tours difficiles.
Elle jonglait avec des
cerceaux, sans rien casser dans la salle,
et se glissait au
travers comme une sauterelle.
Parfois elle faisait la
roue sur les mains et sur les pieds.
Ou bien les deux bras
en l’air et les genoux écartés,
elle se courbait à la
renverse et touchait la terre en riant.
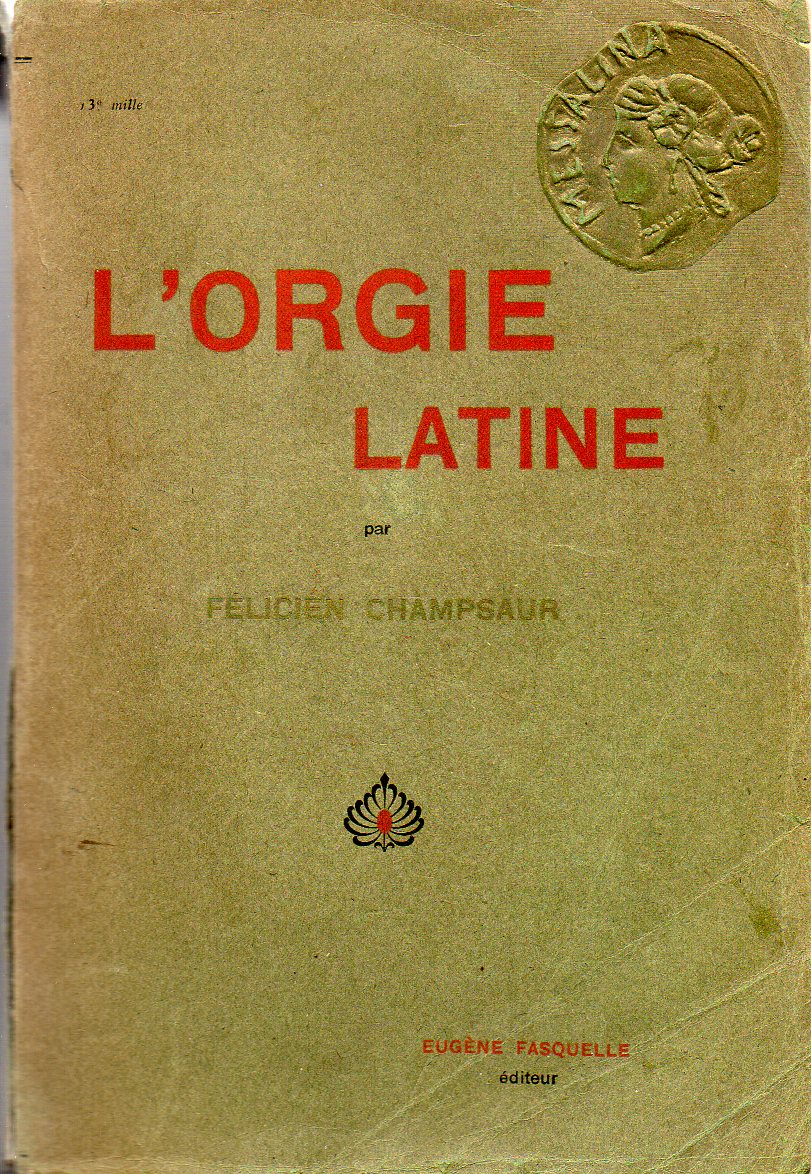
Voilà donc la petite Phryné installée en quelque faubourg
d’Athènes, dans le quartier du Pirée sans doute, où logeaient la plupart des
marchandes de plaisir. La vie populaire menait là son rythme haletant ; il
y avait toute l’écume du port et toute la lie de la grande ville ; le
« Démos » y hurlait ses refrains obscènes ; les pallaques, ces
filles de joie que fréquentaient les matelots, y promenaient leurs loques
rapiécées, mais étincelantes de pierreries fausses ; et l’image de la
Fortune se voyait à tous les carrefours, « relevant sa robe jusqu’au
nombril pour courir plus vite et se donner plus aisément ». L’enfant, qui
n’avait connu jusque-là que le dieu unique, le dieu adorable et mystérieux de
Thespies, tressaillit-elle devant cette déesse à la face vulgaire, offrant ses
charmes au premier venu ? – Ou bien tourna-t-elle ses regards vers la
majestueuse Athenaïa, aux yeux glauques, à l’invincible sourire, qui du sommet
de l’Acropole veillait sur la cité de son choix ? Éprouva-t-elle ce dégoût
de l’orgie, ce premier frisson de la chair innocente devant l’impureté du
monde ? Versa-t-elle quelques larmes vite essuyées avant de se montrer à
demi nue, dans son costume de joueuse de flûte, aux regards cyniques des
soupeurs athéniens ? Tout est possible, tout est dans le coeur de la
femme : la suprême pudeur et la suprême corruption.

Quoi qu’il en fût, elle dut assez vite s’habituer à son nouveau
destin. Elle avait déjà le goût et le désir de l’or ; elle avait été
habituée dès sa plus tendre enfance à l’obligation de travailler pour gagner
son pain ; chez son père elle avait subi les privations quotidiennes de la
misère, et peut-être aussi de durs traitements. Maintenant elle était
libre ! elle pouvait à son gré manger, dormir, bayer au soleil, savourer
sa vie et prendre sa part de la gaîté universelle. Comme toutes les fillettes
de .Béotie, ce pays des chevriers et des chansons, elle avait appris, sans trop
savoir comment, l’art pastoral de la flûte qui dans ces bourgades rustiques
tenait presque lieu de langage et que dans Athènes on abandonnait à des
mercenaires. Ses lèvres posées sur le double roseau qu’assemblait une cire
délicate, elle avait, tout en vendant ses câpres le long des chemins, répondu à
l’appel lointain des bergers. C’était un jeu pour elle que cette musique frêle
et vagabonde comme son âme d’enfant. Dans les sentiers creux, dans les vallées
où la nymphe Écho décuplait les soupirs des hommes, elle avait connu l’ivresse
du son, la panthéistique joie de s’unir par le souffle à tout ce qui palpite et
frémit dans la nature. Artiste ignorée d’elle-même, elle avait mis dans ses
divagations sonores toute la poésie qu’elle avait bue aux fraîches ondes
natales ; et ce qui avait été alors son luxe, l’essor mélodieux de ses
rêves, était de-venu aujourd’hui son gagne-pain. Funèbre ou lascive, la flûte
entre ses lèvres encore virginales traduisait les moindres susurrations de
cette source incomparable d’émois que fut l’âme de Phryné l’hétaïre.
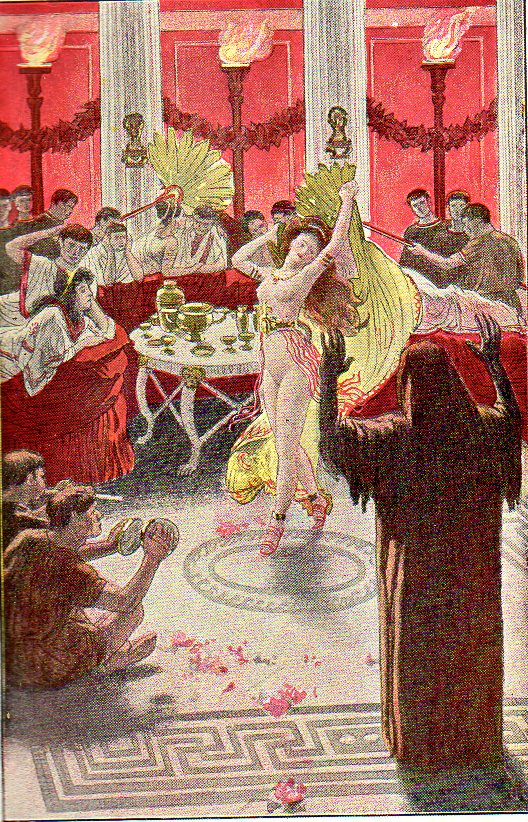
On a tout dit sur les festins des anciens et sur ces orgies
fameuses qu’Athénée s’est plu à nous raconter par les plus menus détails. C’est
lui qui nous apprend le nom des divers instruments en usage dans le concert
antique où les aulétrides semblent avoir tenu le principal emploi. La seule
énumération des flûtes dont on se servait alors, depuis le simple roseau de Pan
jusqu’à la flûte d’argent à sept tubes, occupe tout un chapitre dans le Souper
des savants. Mais la plus répandue devait être celle qu’Anacréon appelle la
« tendre hémope » et que dans ses Odes il associe au parfum des roses
effeuillées, au reflet du vin dans les kantares, aux danses molles et aux
ivresses du baiser. La « tendre hémope » était exclue des concours où
l’on disputait le prix du chant ; elle servait seulement à augmenter
l’agrément des fêtes privées ; elle était un appel à la volupté, un
stimulant du plaisir. Les jeunes aulétrides, sous leurs voiles colorés, en
jouaient devant les convives, et sou-vent elles l’abandonnaient à la fin du
repas pour prendre elles-mêmes part à ces divertissements plastiques dont les
Athéniens du quatrième siècle prisaient fort le charme élégant et pervers.
En même temps que Phryné s’initiait ainsi aux dessous corrompus de
la vie d’Athènes, un changement s’accomplissait peu à peu dans son être
physique. Cette initiation correspondait à l’âge où l’enfant allait devenir
nubile, où le bouton allait éclater et devenir fleur. Comme toutes les filles
transplantées du calme champêtre dans l’atmosphère enfiévrée d’une grande
ville, elle dut subir prématurément cette crise qui allait délier son corps, ce
brusque déchirement des flancs féminins qui est comme une première virginité
perdue et dont s’attendrit le coeur des mères. La pourpre de son sang, teignant
le lin de sa tunique innocente, fut offerte dans quelque carrefour à la Vénus
Physica, en signe qu’une vierge de plus était promise aux caresses de l’amour.
Combien de temps ensuite demeura-t-elle pure avant de connaître l’étreinte du
mâle ? Quel fut-il celui qui, inconscient de son bonheur, dénoua avant
tous les autres la ceinture de la jeune Phryné encore hésitante ?
Peut-être un matelot ivre du Pirée, ou quelque esclave habile dans l’art de
saisir le moment propice ? Et peut-être n’eut-elle pour prix de l’abandon
suprême qu’une insulte à la face ou un horion sur ses flancs blessés ?...
Cette prise de possession comptait alors pour peu de chose, et les Athéniens élégants
en laissaient volontiers le profit à leurs subalternes, estimant sans doute
comme les Sybarites que les molles roses de la volupté sont préférables aux lys
rigides de l’innocence.
Mais ce jour, ou cette nuit, fut dans la vie de la prochaine
hétaïre l’instant décisif sur lequel se règle tout un destin. Une haine à ce
moment entra dans sa chair, avec l’emprise brutale de l’homme. Elle comprit
l’inégalité terrible des deux moitiés de l’humanité, l’iniquité qui pesait sur
la femme, proie offerte aux désirs du plus fort. Et l’idée de la revanche, du
rôle social qu’elle allait jouer, jaillit tout à coup de son rêve obscur, telle
une grande clarté sort des ténèbres à l’heure trouble de l’aurore. Oui,
puisqu’elle était belle, puisqu’elle était jeune, puisqu’elle avait été jetée
toute palpitante dans la fournaise des luxures, elle serait la Ménade
justicière, la Némésis cruelle, qui saignerait les coeurs à blanc, comme le
poulpe vide les coquilles nacrées du rivage. Pour l’avoir désormais, pour se
pâmer contre ses seins en fleur, pour qu’elle noue ses jambes dociles aux reins
tout-puissants d’un maître, elle exigerait de l’or, des boisseaux d’or,
tellement d’or, que la Ruine, le Suicide et le Déshonneur seraient les
commensaux habituels de sa couche. Elle serait une courtisane, l’opprobre et la
splendeur du monde.
III
Il ne faudrait pas croire cependant que la fortune prodigieuse de
Phryné ait été édifiée en un jour. Sa carrière de courtisane, commencée vers la
quinzième année, fut longue et dura autant que sa merveilleuse beauté. Elle fut
comme le resplendissant flambeau de cette époque insigne qui vit fleurir à la
fois Apelle et Praxitèle, Démosthène et Platon ; et si à côté de ces
grands noms son nom a survécu, bien qu’elle ne fût ni poète, ni artiste, ni
philosophe, bien qu’elle n’eût aucun de ces attraits de l’esprit que
possédaient beaucoup de courtisanes, c’est qu’elle fut au plus haut degré
l’expression définitive d’une race chez qui la perfection de la forme humaine
s’égalait presque au génie.
Il suffit de lire Ménandre et Aristophane pour constater quelle
place énorme tenait à Athènes l’élément féminin, avec tout ce qu’il comporte de
dominations apparentes ou secrètes. Les femmes vraiment y régnaient en
souveraines, et il y avait longtemps qu’elles avaient rejeté la loi désuète qui
les vouait à l’ombre du gynécée. Les épouses des archontes, aussi bien que
leurs maîtresses, les riches bourgeoises et les hétaïres, les jeunes filles
honnêtes et les pornées se rencontraient à visage découvert dans toutes les
fêtes publiques, et, à l’heure qui précède le crépuscule, dans cette promenade
fameuse du Dromos qui était le rendez-vous de toutes les élégances de la
ville. Elles menaient le même train de fastueux orgueil, elles rivalisaient-de
parures, de tuniques peintes à la mode asiatique et de bijoux. Les unes en char
ou en litière, Ies autres à pied suivies de leurs esclaves, elles captaient les
regards enivrés des hommes, excitaient l’envie ou le désir. Xénophon nous
apprend qu’il y avait à Athènes une magistrature singulière appelée Gynecosme,
qui forçait les femmes à se parer somptueusement. La rigueur de ce tribunal
était extrême ; il imposait une amende de mille drachmes à toutes celles
qui auraient osé paraître au dehors mal coiffées ou mal vêtues, et leur
infligeait en outre la honte de voir leur nom inscrit sur un tableau qu’on
exposait aux regards du peuple. « La sévérité de cette magistrature,
ajoute naïvement l’historien, produisit un grand mal auquel on ne s’était pas
attendu, car les épouses introduisirent dans les familles un luxe ruineux,
adoptèrent les modes les plus extravagantes et finirent par faire un abus si
révoltant du fard que dans les rues on ne les distinguait plus des
courtisanes. »
Fut-ce pour protester contre cette concurrence des honnêtes femmes
que Phryné la Thespienne, dont la beauté pouvait se passer d’artifices, adopta
une manière d’être tout opposée ? Elle dédaignait le maquillage, les robes
richement peintes, les pierreries, les anadèmes et les joyaux. Seule parmi
toute la foule des Athéniennes qui inventaient chaque jour de nouvelles
parures, elle traversait la place publique, vêtue de la tunique béotienne sans
ornements, et de l’himation, ce grand voile d’étoffe souple qui couvrait même
ses cheveux et retombait jusqu’à ses pieds ; seule, elle ne bleuissait
point ses paupières, et ne teignait point de pourpre ses lèvres assez rouges de
son sang héliconien ; seule, elle avait compris l’attrait de la simplicité
et du mystère.
Dans Athènes ce fut une révolution ; on s’écrasait au passage
de la courtisane ; on voulait apercevoir le peu qu’elle montrait d’elle,
son profil pur, ses larges yeux et l’arc dédaigneux de sa bouche... Mais,
bientôt, elle cessa tout à fait de sortir ; elle se confina dans ses
jardins et dans son palais, une villa aux colonnes doriennes située dans le
quartier neuf du Céramique.
On raconte que Démosthène déjà vieux – peut-être avait-il gagné une
cause sur laquelle il ne comptait point – se rendit un soir à Corinthe pour y solliciter
les faveurs de la célèbre Lais. Mais la belle fille était capricieuse ;
elle préférait les étreintes des vigoureux éphèbes à celles des vieillards les
plus éloquents ; elle fit demander à Démosthène une somme tellement
exorbitante que celui-ci se retira en disant : « Je ne veux pas
acheter si cher un repentir ».
Phryné n’agissait point de la sorte ; elle n’avait ni
préférence, ni dégoût. Peu lui importait que ses amants fussent jeunes ou
vieux, séduisants ou laids ; elle ne cherchait point le plaisir, elle
voulait seulement le donner. Artiste incomparable dans le drame aigu de
l’amour, sa jouissance était seulement de vaincre. Elle savait bien que,
passionnée, ardente, elle deviendrait semblable aux dictériades vulgaires qui
dans les prostibules du Pirée haletaient aux bras des matelots. En se faisant
courtisane, elle avait imposé silence à ses sens ; elle haïssait le
« mouvement qui déplace la ligne », les rires et les pleurs
convulsifs de la volupté ; aussi gardait-elle son divin prestige et l’attrait
de sa beauté en tous points admirable, mais qui, au dire d’Athénée,
« était admirable surtout dans ce que l’on ne voyait pas ».

Il est certain que le culte, ou plutôt la culture, de cette beauté
devait occuper tous les instants que la jeune Thespienne ne donnait point à
l’amour. Orgueilleuse de son corps parfait, elle devait par tous les moyens
possibles en augmenter chaque jour l’harmonie et la délicatesse. Si elle
dédaignait les fards et les cosmétiques grossiers, elle n’en devait être que
plus attentive à surveiller les moindres changements de cette argile
constamment en travail dont est faite la chair féminine ; et, s’il était
très difficile d’obtenir qu’elle ôtât son dernier voile, elle devait réserver
sa nudité enivrante pour le tête-à-tête avec le grand miroir d’argent qui la
reflétait tout entière. Là, Phryné, comme Narcisse devant l’onde d’Hippocrène,
s’exaltait à sa propre contemplation ; et, se souvenant de son ingrate
enfance, de son adolescence humiliée, et laissant son coeur déborder de joie,
peut-être baisait-elle son image pour remercier les dieux de lui avoir accordé
ce don souhaité de toutes les femmes : la pure, la triomphale Beauté. Au
reste, elle semble avoir eu et gardé toute sa vie l’affection de ses camarades,
les autres hétaïres d’Athènes, qui l’admiraient et ne la jalousaient point.
Selon la coutume grecque, elle les réunissait quelquefois en des banquets d’où
les hommes étaient exclus. C’étaient alors entre elles les confidences et les
expansions interminables des esclaves de l’amour qui, même échappées au joug du
maître, portent partout comme un stigmate la préoccupation incessante de lui
plaire. Phryné souriait en les écoutant ; son beau regard allait retrouver
la mer violette qui, au-delà des jardins plantés de grands rosiers pourpres,
ondulait à l’infini vers l’Orient ; elle souriait : l’inquiétude
éternelle n’avait point pénétré dans son coeur, et le dieu de Thespies qui la
protégeait avait laissé intacte sa sensibilité secrète.
Ce fut sans doute dans une de ces ripailles intimes que se place
l’anecdote rapportée par plusieurs auteurs anciens : à la table de Phryné
les courtisanes étaient assemblées comme une guirlande de fleurs
éclatantes ; elles se reposaient des nourritures épicées dont se délectent
les hommes, en mangeant les mille friandises agréables aux gosiers
féminins : les croquettes de fleurs, les crèmes d’amandes, les fruits
délicats, et en buvant l’hydromel qui rend le teint luisant et clair. La douceur
du soir entrait par la large baie ouverte ; les arômes du jardin se
mêlaient à l’odeur musquée des fritures ; et les jeunes femmes,
s’abandonnant au charme de cette heure de paresse, dégrafaient leurs gorgerins
et dénouaient les rubans de leurs chevelures. Les seins lourds apparaissaient,
pareils à de beaux fruits veloutés ; les boucles brunes ou blondes
tombaient sur les épaules lisses ; sous les aisselles soigneusement
épilées et creuses, telles des castagnettes de Lydie, les petites boules d’ambre
jaune ne mettaient plus leur fraîcheur : elles roulaient sur la table,
parmi les cratères et les coupes, y promenaient de tièdes relents de
chair ; mais personne ne s’en troublait. On avait tiré au sort la royauté
du festin, et c’était à Phryné qu’elle était échue ; elle commandait donc
deux fois, et comme maîtresse de maison et comme souveraine éphémère. Elle
aussi avait ôté de ses cheveux les bandelettes de pourpre et relâché les liens
de sa tunique ; à la lueur mouvante des flambeaux, son beau visage et le
galbe de son cou de déesse se révélaient dans leur immaculée splendeur.
– Il faut avouer, dit alors l’une des jeunes hétaïres, que notre reine
nous dépasse toutes dans l’art de dissimuler les artifices de la toilette.
Regardez-la. Ne dirait-on pas qu’elle sort de la piscine ?
– En effet, répondit Phryné ; je n’ai pas d’autre fard
que celui-ci. Jamais aucune composition savante n’a effleuré ma peau.
Et comme des murmures de doute s’élevaient de toutes parts, elle
fit signe à l’enfant qui les servait de placer devant elle un bassin d’eau
claire ; et largement elle s’en épongea la face.
– Et maintenant faites-en autant, ordonna-t-elle à ses
compagnes.
Les courtisanes obéirent ; ce jeu les amusait déjà, et l’eau
fraîche parfumée de serpolet qui oscillait dans les bassins de cuivre tentait
leurs visages échauffés. Puis, chacune espérait peut-être découvrir en sa
voisine quelque tare soigneusement cachée. Et à mesure que les ablutions se
poursuivaient, l’eau claire dans les bassins de cuivre prenait les nuances fugitives
de l’arc-en-ciel, tandis que les visages décolorés perdaient peu à peu leur
éclat... Le rire frais de Phryné retentit comme au temps où, pieds nus, elle
courait avec les pâtres sur les chemins herbeux de la Béotie. Elle seule
sortait triomphante de ce singulier concours de beauté.
– Voyez, dit-elle, les yeux de la Thespienne ne mentent pas
plus que ses lèvres.
L’anecdote, si elle n’est pas absolument authentique, marque du
moins d’un trait assez expressif la physionomie de la fameuse hétaïre. De même
qu’elle dédaignait les subtilités des rhéteurs et les phrases imagées des
poètes, elle méprisait les supercheries vaines qui s’ajoutent aux rites sacrés
de la volupté. Son charme irrésistible émanait d’une puissance autrement
redoutable, d’une puissance aussi antique que le monde : elle était
seulement LA CHAIR !
IV
Phryné-Charybde, c’est ainsi qu’au bout de très peu de temps on
avait surnommé là courtisane. L’esprit caustique des Athéniens excellait à
placer ainsi à côté du nom des citoyens illustres l’appellation qui les
définissait le mieux. Et Phryné, dont les coffres insatiables se remplissaient
de tout ce qu’elle enlevait à la fortune publique, était comparée à ce gouffre
de Sicile qui engloutissait tout ce qui avait l’imprudence de s’engager dans
ses écueils.
Cependant, on ne lui en tenait pas rigueur.
Certains moralistes indulgents – comme il y en avait beaucoup à
Athènes – prétendaient au contraire qu’en mettant à si haut prix ses faveurs
elle avait réveillé dans la ville l’esprit de négoce, et qu’il était bon qu’on
attisât ainsi l’ambition, la vanité, la sensualité des citoyens de la
République. A cette époque, l’axe de la propriété commerciale s’était déplacé,
et c’était Rhodes l’Opulente qui détenait pour un court instant la
thalassocratie, c’est-à-dire l’empire des mers. C’étaient les agiles bateaux
rhodiens qui sillonnaient la Méditerranée en tous sens, abordaient tous les
rivages, touchaient tous les points du monde civilisé, et revenaient dans
« l’île heureuse » chargés d’or brut et de trésors. Athènes avait
cessé de tenir le premier rang dans l’énumération des grandes cités maritimes
et ses trois ports du Pirée, de Munychie et de Phalère ne contenaient plus que
la moitié des vaisseaux qui s’y pressaient autrefois. Le goût des arts, le charme
de cette vie facile avaient affaibli dans le peuple d’Athènes l’amour des
périples lointains. A quoi bon s’embarquer, alors qu’il suffisait de prendre
les rampes dorées de l’Acropole pour jouir du plus beau spectacle dont
pouvaient s’enivrer des regards humains ! La ville avec ses temples, ses
statues, ses portiques de marbre, et les oasis vertes de ses jardins, la ville
avec ses éphèbes blonds, ses vierges au profil de Diane, ses femmes, ses
athlètes et ses dieux, ne suffisait-elle pas à remplir du vin de la joie la
coupe peu profonde où chaque mortel boit goutte à goutte sa vie ?
Phryné avait changé tout cela. Désormais tout jeune Athénien
souhaitait de s’enrichir promptement pour posséder la créature merveilleuse et invisible
dont on ne pouvait approcher que les mains ruisselantes d’or. On se figure
qu’elle était le sujet principal des entretiens dans les gymnases, aux jardins
du Koïlé, sur les bancs de pierre des allées d’Académos, partout enfin où se
réunissait l’élite de la jeunesse athénienne. Avoir pénétré chez l’hétaïre,
raconter son luxe digne d’une reine asiatique, énumérer les présents dont ses
amants d’une nuit l’avaient comblée, devait être de la suprême élégance ;
on s’en vantait autant que d’une victoire remportée sur le stade glorieux
d’Olympie, en ces joutes équestres où les Athéniens se flattaient de faire
courir les plus beaux chevaux de la terre. Mais les riches étrangers, les
« métèques » qui venaient à Athènes jouir de la vie opulente, Égyptiens,
Syriens, Italiotes, dont les talents et les mines ne se comptaient plus,
c’étaient ceux-là surtout qui fréquentaient le palais de la courtisane. Et
orgueilleux, le sourire aux lèvres, laissant traîner dans la poussière leurs
manteaux brodés de lotus, ils disaient à demi-voix des choses qui faisaient
monter aux joues des moins fortunés la pâleur froide du désir.
Ainsi Phryné-Charybde attirait-elle à soi toutes les aspirations
errantes des hommes. On assurait même que le marché des complaisants éphèbes
aux yeux peints, à la peau soyeuse, en était tombé en discrédit. Et cela encore
contentait les moralistes. Il était temps que le souffle d’une femme balayât
cette corruption dont toutes les classes avaient fini par être envahies. En
vain Solon, dans ses Constitutions, avait-il préconisé l’amour des
belles hétaïres comme « le moyen le plus efficace pour lutter contre le
vice masculin ». Sagesse inutile ! Mais Phryné était apparue et le
courant des passions malsaines s’était détourné, et une grande flamme brûlait
des profondeurs de la ville vers l’idole souriante et charnelle, dont tout
adolescent rêvait de baiser les beaux pieds nus.
Il semble que, parvenue au comble de la fortune et ne sachant plus
que faire de ses trésors, Phryné ait convoité une couronne plus glorieuse.
C’était le moment où Alexandre le Grand, tout jeune encore mais impatient de
conquêtes, venait de succéder à son père Philippe. La Macédoine était pour lui
un royaume trop étroit : il lui fallait mesurer son ardeur et la force de
son génie avec des puissances rivales. Vivre dans la paix lui eût semblé
déchoir. Ce fut sur Thèbes de Béotie qu’il porta d’abord son premier élan.
Cette ville, longtemps rivale d’Athènes, mais maintenant coalisée avec elle
contre le péril nouveau qui les menaçait toutes deux, était une des plus
puissantes parmi les métropoles de la Grèce. Pausanias nous apprend que son
enceinte de murailles, sur laquelle s’ouvraient sept portes d’airain, mesurait
quarante trois stades ; qu’elle possédait des monuments admirables, une
statue colossale d’Hercule Protecteur, un temple dédié à Apollon Isménien, et
une figure de Mercure debout, sculptée par Phidias. La bravoure des Thébains,
de même que leur rudesse, était proverbiale, et le fameux « bataillon
sacré », composé de trois cents jeunes gens élevés en commun et nourris
dans la citadelle, avait longtemps passé pour invincible. Une proie si
difficile devait, tenter l’âme héracléenne d’Alexandre, qui prétendait porter
lui-même dans ses veines le sang, du héros. Démosthène le raillait et le
traitait d’enfant agité ; « l’enfant agité » allait montrer que
désormais il faudrait le considérer comme un homme. En posant le siège devant
la ville de Cadmus, il exhorta ses soldats de ne pas fléchir. Les Thébains,
d’ailleurs, avaient déclaré qu’ils n’accepteraient aucune merci, et déjà ils se
ruaient sur les remparts et prenaient l’offensive avec une fureur tout antique.
Cette lutte fut une des plus émouvantes que nous ait rapportées l’histoire. On
sait comment Thèbes fut enlevée et détruite de fond en comble : les corps
de six mille citoyens passés au fil de l’épée : tous les autres habitants
emmenés en esclavage ; tous les monuments brûlés ou anéantis à coups de
hache ; – et, sur ce vaste champ de ruines, une seule maison, petite et
basse, restée debout : celle où était né le poète Pindare, et
qu’Alexandre, par une coquetterie de vainqueur, avait ordonné qu’on respectât.
Il est facile de comprendre quelle angoisse dut saisir Athènes à
cette nouvelle. Après avoir subi elle-même les horreurs de la guerre Médique,
elle voulait, elle recherchait la paix, – la paix favorable aux arts, au
bien-être, au progrès de la science, aux nobles émulations de l’esprit.
L’olivier de Minerve, que la déesse de ses mains secourables avait planté sur
l’Acropole, lui était plus cher que tous les lauriers de Mars. Mais que rêvait
Alexandre après ce premier exploit ? N’allait-il pas essayer d’anéantir
Athènes comme il avait anéanti Thèbes, et porter une main sacrilège sur cette
reine de beauté qui était l’ornement du monde ?...
L’ouragan avait passé : le jeune conquérant tournait ses pas
vers l’Asie, après avoir exigé seulement des archontes l’exil de l’orateur
Charidème, qui, avec Démosthène, avait été un de ses plus énergiques censeurs.
Et les Athéniens légers reprenaient déjà le rythme de leur vie de dilettantes.
Seule peut-être, Phryné gardait saignante en son coeur la blessure faite à sa
contrée natale. Thèbes détruite, c’était la Béotie tout entière découronnée,
c’était le lien qui unissait entre elles les autres villes de la Confédération
béotienne – Tanagre, Thespie, Éleuthère, Platée – tombé en poussière et
laissant désormais une menace d’anarchie ou de décadence flotter sur cette
terre sacrée des Aones. Personne, cependant, ne bougeait ; personne ne
parlait de relever promptement ces ruines... Cela coûterait. un tel effort
héroïque ! II faudrait tant de mines d’argent, tant de statères d’or, pour
faire renaître une seconde Thèbes semblable à la première et munie des mêmes
formidables défenses ! Il faudrait tant de maçons pour rebâtir ses
murailles, tant d’ingénieurs pour rétablir ses canaux, tant d’architectes pour
dessiner le plan de ses temples, tant d’artistes pour les orner de statues et
de fresques aux vives apparences !... Plutôt que de tenter ce tour de force
irréalisable, la Grèce indifférente gardait cette plaie ouverte à ses flancs...
Alors Phryné sortit de son silence. Elle avait réfléchi. Son
dessein était mûr : ces richesses inutiles dont elle ne savait plus que
faire, ces trésors qui dormaient au fond de ses coffres comme des bêtes
enchaînées, elle allait en créer cette chose frémissante et féconde : la
vie d’une grande cité. Grâce à elle, Thèbes reprendrait sa place au soleil...
Orgueilleux Alexandre ! Tu avais cru pouvoir effacer de la Terre cette
rivale de la Macédoine qui gênait tes ambitions. Tes soldats avaient égorgé et
pillé sans merci, et mêlé avec le sang des vaincus la poussière blanche des
marbres. Mais de ce ciment épais et gras, de ce fumier où ton talon de
vainqueur brutal avait enfoui l’opprobre d’un peuple, une fleur magnifique
sortirait, une fleur plus éclatante et plus fraîche dont s’étonneraient les
générations des hommes. Et ce miracle, ce serait une courtisane qui
l’accomplirait...
Phryné avait fait parvenir aux Béotarques chargés des intérêts de
la Confédération sa proposition généreuse. Elle n’y mettait aucune
réserve ; elle s’engageait à fournir jusqu’à la dernière drachme l’argent
nécessaire à la reconstruction de la ville ; elle demandait seulement que
sur les portes d’airain on inscrivît cette formule laconique :
« Thèbes détruite par Alexandre, reconstruite par Phryné la
Thespienne. »
Et elle attendit, prête à tenir sa promesse. Le sacrifice qu’elle
s’imposait, elle qui certainement avait eu depuis sa tendre jeunesse le
vertige, l’éblouissement de l’or, elle qui n’avait posé d’autre but devant sa
vie que de s’enrichir, ce sacrifice d’une fortune acquise par l’incessant
abandon d’elle-même à tous paraîtrait inexplicable, si on s’en tenait à la
simple logique des choses. Mais pénétrons plus avant dans les arcanes secrets
de ce coeur ; comme dans un beau fruit, un ver s’y est glissé, qui le
ronge et le dessèche : Phryné est riche, elle est admirée, elle est
enviée ; tous ses désirs sont satisfaits ; il ne lui manque qu’une
chose : le respect qui est accordé aux autres êtres, à tous ceux qui ne
sont pas déchus ; et elle rêve de faire de cet or qui a payé sa honte
l’instrument de sa réhabilitation ; elle veut jouer un rôle·dans cette
société humaine, où jusqu’à présent elle n’a été considérée que comme .un objet
méprisable. Elle veut l’estime des hommes.
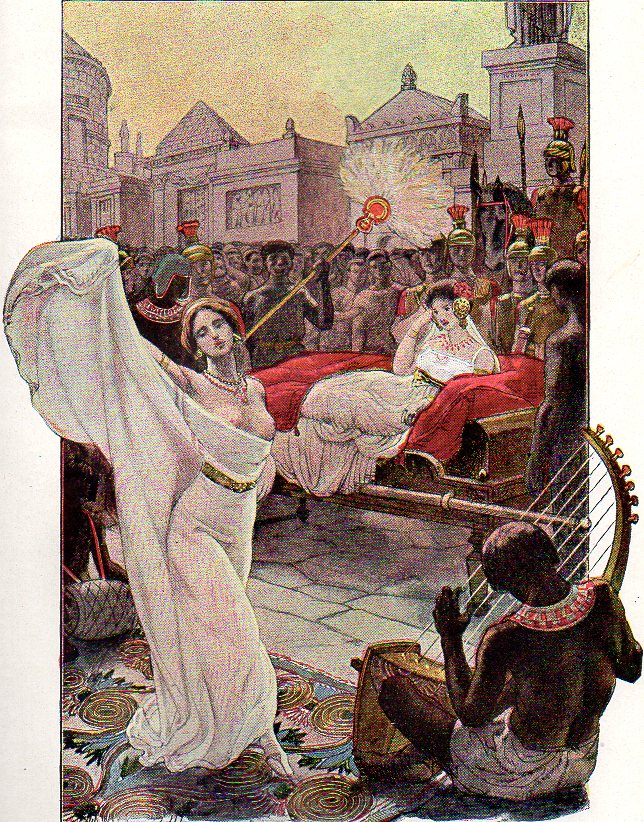
Mais voici ce que la société lui répond par la bouche des
Béotarques :
« Non, courtisane, nous ne voulons pas de ton or. Ton or
souillerait la citadelle de la ville, le lit des chastes épouses, l’épée des
héroïques soldats, le temple où repose la divinité ; il corromprait l’eau
fraîche des sources, où les jeunes filles vont baigner leurs pieds ; il
salirait jusqu’aux mains sordides des mendiants qui le soir errent de porte en
porte, réclamant l’aumône du pain. Nous ne voulons pas de ton or, l’or de tes
nuits d’orgie et de tes baisers impudiques. Garde ton ver dans le coeur ;
nous garderons notre blessure. »
Retourne, hétaïre, à ton vomissement ! Roule-toi aux bras de
tes amants, enveloppe-toi dans ton infamie comme dans le suaire sans coutures
dont on revêt les morts au cercueil. Alexandre peut traîner sur ses pas le
viol, le meurtre et l’incendie, il n’en est pas moins un héros. Mais toi,
Phryné, tu es le rebut et l’opprobre du monde !
V
D’après des calculs d’Émeris-David, qui paraissent assez exacts, le
sculpteur Praxitèle devait avoir vingt-six ans lorsqu’il conçut sa grande
passion pour l’hétaïre. C’était vers le milieu de la cent onzième olympiade,
par conséquent très peu de temps après la prise de Thèbes, qui correspond à la
deuxième année de ce même cycle (335 avant Jésus-Christ).
Le jeune Praxitèle n’avait pas encore atteint cette renommée qui
devait porter son nom à tous les confins de la terre. Il était cependant
presque célèbre, puisque Pausanias relate qu’à la mort de Philippe, Alexandre,
devenu roi de Macédoine, hésita un instant à lui confier le soin d’élever sa
statue. « Mais, ajoute l’historien, le nouveau roi lui préféra Lysippe,
dont la réputation était mieux assise. » Lysippe, en effet, s’était, dès
la cent deuxième olympiade, illustré dans la statuaire gymnique, en sculptant
différentes figures d’athlètes, notamment celle de Pyrrhus d’Élée ; et,
malgré les systèmes chronologiques de Winckelmann et de Heine, il est à peu près
établi maintenant qu’il a précédé Praxitèle d’une vingtaine d’années dans la
carrière artistique. Ce fut donc lui qui bénéficia du fameux édit par lequel
Alexandre confiait « au seul Apelle le soin de peindre son image, au seul
Pyrgatèle celui de la graver sur les pierres précieuses, et au seul Lysippe
celui de l’exécuter en bronze ».
On conçoit que cette préférence dut attrister comme une injustice
l’âme déjà glorieuse de Praxitèle. Il venait d’achever la suite des bas-reliefs
qui, au témoignage de Strabon, couvraient presque en entier l’autel du nouveau
temple d’Éphèse ; il avait aussi exécuté pour l’Acropole cette délicate
figure de Diane Brauronia, dont la grâce jeune et souple contras-tait si
étrangement avec les imposantes et froides divinités que Phidias avait évoquées
dans l’ivoire et l’or. On disait de lui qu’il allait renouveler l’art grec, et
y ajouter une sensibilité inconnue des maîtres du passé. On attendait... et les
regards de tous les Athéniens, amoureux de la beauté plastique, se tournaient
vers lui.
Phryné ne pouvait ignorer les espérances que l’on fondait sur le
jeune émule de Lysippe. Elle savait que dans son atelier d’autres oeuvres se
préparaient en silence ; que sa maîtresse Cratina, celle-là même dont saint
Clément d’Alexandrie dans les Stromates confirme l’existence, lui
servait de modèle pour de nouvelles statues de femmes ou de déesses ; que
de tous côtés les jeunes Grecques aux belles formes, les filles du peuple et
les jolies esclaves allaient s’offrir pour poser devant lui et gagner ainsi
quelques drachmes généreusement payées. Néanmoins, Praxitèle devait en être
encore à chercher sa voie ; il ne s’était pas entièrement dégagé des
influences de l’école ; la formule définitive où se fixerait son génie ne
lui était pas apparue. Phryné savait tout cela, et que dans-un des faubourgs
d’Athènes, pendant que sa beauté à elle enivrait de fastueux amants, un
artiste, ce fils préféré des dieux, peinait son labeur et était aux prises avec
la chimère décevante et captieuse de l’idéal. Alors un matin, comme le soleil,
ce « rouge taureau du jour », quittait les prairies humides de
l’Eubée, et commençait à dorer de ses reflets les sommets, de l’Acropole,
Phryné sortit de son palais et simplement se rendit chez Praxitèle.
Ce dut être un ravissement pur, une minute d’émotion sublime.
L’artiste et la courtisane face à face, ardents et jeunes, n’avaient pas songé
d’abord à autre chose qu’au geste ancestral de l’amour. Mais de cette étreinte
devait naître toute une génération de chefs-d’oeuvre... Maintenant Phryné ne
sentait plus sur sa poitrine le poids étouffant du déshonneur !... Elle se
moquait du mépris des Béotarques et de l’indignation des femmes honnêtes. Elle
avait fait cette chose magnifique, elle, l’hétaïre la plus chèrement cotée de
la Grèce, de se donner pour rien à un homme parce que cet homme était un
artiste ; la Beauté et le Génie avaient échangé ce pur et divin baiser,
dont le Christ lui-même devait dire qu’il rachète et absout les plus viles turpitudes
des pécheresses. Son âme était lavée par l’eau du torrent ; elle pouvait
relever la tête et respirer librement. Cet allégement, cette force, cet orgueil
que donne l’amour, elle les ressentait dans tout son être. Elle marchait,
environnée de ce nimbe qui la faisait sainte et auguste. Etre la maîtresse de
Praxitèle, l’inspiratrice de son génie, l’amie patiente qui attend, qui écoute,
qui sourit ; celle qui retrouve la simplicité de l’adolescence dans les
chemins où l’on s’en va deux à deux cueillir de puériles fleurs, et celle
encore qui, maternelle, protège la faiblesse de l’homme, sachant que, pour
produire l’oeuvre difficile, il a besoin de la caresse de ses regards !
Voilà ce que Phryné était devenue.
Quant à Praxitèle, on peut deviner quelle extase devait être la
sienne : il tenait enfin, il possédait la chair palpitante et docile, le
modèle incomparable que jusqu’à présent il avait vainement cherché. Cette
sensualité double qui circulait dans ses veines avec son sang et qui fait le
tourment de tous les artistes, cette sensualité double qui tend vers un but
unique, il trouvait cette fois la plus magnifique occasion de la satisfaire.
Dans·l’atelier encombré des archaïques figures d’Assyrie ou d’Égine, des
sévères images de pierre ou de bronze où toutes les époques, tous les styles
sont rapprochés, voici Phryné nue et souriante devant lui. Elle lève ses bras,
elle infléchit son torse d’une harmonie si suave, elle se courbe, se tourne, se
redresse... C’est Aphrodite, la volupté du monde ; c’est la vierge Artémis
surprise sans voile au bord de la source où la guette le chasseur
Endymion ; c’est la victorieuse Nikè, dont le sourire triomphe des
embûches du Destin ; c’est la Femme, éternelle et divine, qui pour être
adorée n’a pas besoin de porter le nom d’une des déesses de l’Olympe. Et
Praxitèle s’enivre de cette joie excitante de créer ; il oublie même la
griserie des baisers charnels pour cette supérieure ivresse ; il
travaille, il anime la matière, il fait vivre la froideur du marbre. Il est sûr
désormais que de ce tourment obscur qu’il portait dans ses entrailles va sortir
la réalisation de son génie.
L’énumération des oeuvres du grand artiste a été faite bien des
fois ; elle est longue et infiniment glorieuse ; mais il est à
remarquer que l’exécution de ses plus grands chefs-d’oeuvre correspond à
l’époque de sa liaison avec Phryné. Ce sont d’abord les deux statues de la
courtisane elle-même mentionnées par Callistrate, et qui furent placées, l’une
dans le temple de Delphes (celle-ci en bronze), l’autre dans le temple de
Thespies (celle-là en marbre) ; puis les deux fameuses Vénus de Cos et de
Cnide, qui étaient, elles aussi, la reproduction fidèle des traits de la
courtisane. Une scolie de saint Clément d’Alexandrie peut faire supposer,
cependant, que Cratina, qui avait été avant Phryné la maîtresse de Praxitèle,
posa pour l’ébauche de la Vénus de Cnide ; mais tous les auteurs anciens
sont unanimes à reconnaître que Phryné en fut le définitif modèle.
Pline raconte l’histoire de cette admirable Vénus de Cnide, dont il
assure qu’elle était « le plus bel ouvrage, non seulement de la Grèce mais
du monde entier ». Elle était destinée d’abord au temple de Cos ;
mais les prêtres et les habitants de la ville se troublèrent devant cette
nudité si étrangement voluptueuse, et ils demandèrent à l’artiste d’exécuter
pour eux une seconde image de la déesse, voilée d’une draperie à mi-corps. Les
Cnidiens, moins scrupuleux que leurs voisins et mieux habitués, sans doute, aux
mollesses des cultes de l’Asie Mineure, achetèrent alors cette première Vénus,
qu’ils placèrent dans la cella de leur temple, où elle attira bientôt une foule
de visiteurs. « De tous côtés de la Terre, dit Pausanias, on vient à Cnide
admirer l’Aphrodite de Praxitèle. » Elle était en marbre blanc, ajoute
l’historien, et placée de telle sorte qu’on pouvait l’admirer de dos, de face
et des deux profils. Une grille d’or l’entourait et la protégeait contre les
attouchements indiscrets de la foule ; précaution sage, car elle devait
inspirer des passions sans nombre. Lucien (Dialogue de l’Amour) raconte
comment un jeune Cnidien, d’une famille distinguée, devenu éperdument amoureux
d’elle, se laissa enfermer une nuit dans le temple... Mais cette anecdote est
trop scabreuse pour trouver ici sa place.
Maintenant est-il exact de dire, comme on l’a fait tant de fois,
que Praxitèle fut le premier sculpteur grec qui ait osé montrer la forme
humaine dans sa vérité ? Non, sans doute ; et dans la seule Acropole
d’Athènes Beulé cite un certain nombre de figures entièrement nues dues au
ciseau de Phidias et de ses élèves, notamment une Vénus, deux Éros
et une représentation symbolique de l’Ilissus. Les Précurseurs eux-mêmes, ces
grands artistes rigides et réalistes du sixième siècle, avaient laissé toute
une série de statues d’athlètes, de dieux et de déesses, qui étaient l’exacte
reproduction du corps humain. Mais Praxitèle fut très probablement le premier à
lui donner cette morbidesse, cette vénusté, cette souple et provocante
séduction et, selon l’expression de Lucien, « cette vie sourde et prête à
se manifester du marbre amolli », qui avait troublé si fort les honnêtes
habitants de Cos et qui attira à la Vénus de Cnide l’outrage que rapporte le
spirituel auteur des Dialogues. Et ce qui apparaît aussi comme à peu
près acquis d’après les importants travaux faits depuis une soixantaine
d’années sur la statuaire grecque, c’est que Praxitèle fut aussi l’un des
premiers à se servir du marbre pur, sans le surcharger d’aucun ornement, du
marbre blanc et nu, tel qu’il sortait des carrières de Paros. Avant lui,
c’était la sculpture chryséléphantine qui dominait, même au Parthénon, où
régnait l’admirable Athenaïa d’ivoire et d’or de Phidias ; presque tous
les artistes polychromaient leurs statues, les enveloppaient de feuilles de métal,
ou les ornaient d’orfèvreries précieuses. Lysippe lui-même ne laissait pas
sortir une seule statue de son atelier, sans l’avoir confiée auparavant à son
ami Apelle pour qu’il la revêtit d’un enduit dont ce peintre célèbre avait le
secret. Pline va jusqu’à prétendre que Phidias ne travailla jamais le marbre,
ce qui évidemment est exagéré. Mais ce que l’on peut déduire de cette
assertion, comme l’a fait M. Boutmy, c’est que Phidias fut le dernier des
grands artistes grecs qui ait été de préférence un « toreuticien »,
c’est-à-dire un orfèvre dans le genre colossal, tandis que Praxitèle fut le
premier à associer ces deux choses qui semblent vouées à de secrètes et
profondes harmonies : la nudité de la chair et la nudité du marbre.
C’est Phryné sans doute qui posa aussi pour son amant cette Jeune
Femme s’ajustant une couronne, emportée à Rome par Caligula, et dont les
bras soulevés dégagent et exaltent l’orgueilleuse nudité des seins ; – et
c’est elle encore qui lui inspira l’idée originale de ces deux statues qui se
faisaient pendant sur une promenade publique d’Athènes : l’Honnête
femme qui pleure et la Courtisane qui rit.
On dit que pour remercier Phryné de lui avoir si souvent servi de
modèle, Praxitèle lui offrit un jour de choisir parmi les chefs-d’œuvre de son
atelier celui qui la séduisait davantage. La courtisane hésita longtemps entre
deux figures d’adolescents grandis, presque des hommes, à qui l’artiste avait
prêté la même inimitable grâce : c’était l’exquis Faune en marbre
qui fut placé plus tard dans la rue des Trépieds, à Athènes, et surnommé le Periboctos
à cause de sa beauté, et un Éros de marbre aux ailes d’or. Elle se
décida pour ce dernier, et n’eut pas à se repentir de son choix. Cet Éros, au
témoignage des contemporains, était surtout merveilleux par l’expression
adorable de son visage. « Il penchait un peu sa tête pensive et souriait
doucement. » Une épigramme de l’Anthologie, attribuée à Palladore, le
dépeint ainsi : « Cet Amour est nu ; voyez comme il est doux,
comme il sourit. C’est qu’il n’a ni son arc, ni ses traits méchants ; mais
dans ses mains il tient un dauphin et une fleur : dans l’une la Mer, et la
Terre dans l’autre. » Une autre épigramme de Simonide : « Cet
Amour dont il a subi la force, Praxitèle en a tiré l’image de son propre coeur. »
Une autre de Léonidas : « Les Thespiens n’ont de culte que pour
l’Amour, le fils de Cythérée, et ils ne l’honorent pas sous une autre forme que
celle où il s’est révélé à Praxitèle. L’artiste, qui l’avait vu dans les yeux
de Phryné, l’a reproduit dans la statue dont il lui a fait hommage. »
Par une touchante manifestation de sa piété envers sa ville natale,
Phryné voulut offrir à son tour au temple de Thespies l’admirable Éros que lui
avait donné Praxitèle. Lucien rapporte qu’il y remplaça la primitive image du
dieu, et qu’il était considéré comme l’objet le plus précieux du temple. Plus
tard, il fut emporté en Italie, et, si l’on en croit Cicéron, gardé
précieusement par Verrès qui l’avait enlevé, nous dit-il, à un riche citoyen de
Messine ; – ce même Verrès qui fut condamné à l’exil et à la mort pour
n’avoir pas voulu céder au triumvir Marc-Antoine deux magnifiques vases de
Corinthe ! Plusieurs répliques de ce chef-d’oeuvre existaient dans
l’Antiquité ; on en cite une que possédait Glycère la courtisane. Est-ce
une des ces répliques, est-ce une copie du précieux Éros de Thespies, dépouillé
de ses ailes d’or, qu’aujourd’hui encore on peut admirer au Vatican sous le nom
du Cupidon Antique ? Ne soyons pas trop pressés d’affirmer ou de nier, et
contentons-nous d’imaginer ce que devait être la beauté de l’Éros véritable,
tel qu’il sortit des mains mêmes de Praxitèle, puisque ce qui en est resté à
travers les siècles nous donne une si poignante émotion d’art.
VI
Phryné-Aphrodite, ce surnom remplaçait désormais celui de Charybde
par lequel on avait raillé la cupidité de la courtisane. Praxitèle avait fait
d’elle une seconde Vénus et l’avait désignée ainsi à l’adoration des
foules ; et très vite elle s’était habituée à ce rôle pour lequel vraiment
il semblait qu’elle fût née.
Ici se place la partie la plus mystérieuse, la plus impénétrable de
l’existence de la Thespienne, celle qui devait amener contre elle cette fameuse
accusation d’impiété qui faillit lui coûter, la vie. On sait qu’à cette époque
l’infiltration des cultes étrangers – en particulier ceux de l’Asie
Mineure – commençait à corrompre la Grèce. A côté de la religion
officielle et tout intellectuelle de Minerve-Parthénos, la Vierge invincible,
il existait dans Athènes sous le nom de thiases des sociétés secrètes dont les
membres se réunissaient pour célébrer les rites impurs du Sabazios lydien et de
la Cotytto phrygienne. Dès la fin du cinquième siècle, le poète Eumolpe, ce
rival parfois heureux d’Aristophane dans la comédie ancienne, avait composé une
pièce satirique, les Baptes, dans laquelle il tournait en ridicule les
adeptes de ces sectes secrètes. Mal lui en prit d’ailleurs, car il fut jeté à
l’eau nuitamment, et l’on accusa même Alcibiade d’avoir préparé cette
vengeance. Plus tard, les mêmes sociétés secrètes, les mêmes pratiques
clandestines, se propagèrent à Rome. Juvénal, avec sa verve cinglante, en a
tracé un inoubliable tableau : « On sait à présent, dit-il, ce qui se
passe dans ces assemblées quand la trompette agite ces Ménades et qu’également
ivres de son et de vin elles font voler en tourbillons leurs cheveux épars... Là rien
n’est feint : les attitudes y sont d’une telle vérité qu’elles auraient
enflammé le vieux Priam et l’infirme Nestor. » Puis, dans une autre
satire, il rejette la responsabilité du mal sur cette Grèce à laquelle les
Latins avaient presque tout emprunté : « Ainsi, conclut-il, les Baptes
célébraient dans Athènes, à la lueur des flambeaux, leurs nocturnes orgies et
par des danses lascives fatiguaient leur Cotytto. »

Phryné était-elle réellement affiliée à l’une de ces thiases,
et faisait-elle célébrer chez elle les mystères asiatiques, en se réservant le
rôle de Cotytto, ou se contentait-elle d’un simulacre ? Il serait difficile
de le dire. Toujours est-il que certaines nuits son palais se remplissait de
gens aux allures mystérieuses qui venaient sans doute adorer sous ses traits
l’impure déesse phrygienne. Et sans doute aussi Praxitèle, amusé de voir sa
maîtresse ainsi déifiée, réglait-il lui-même les détails esthétiques de ces
fêtes. Que s’y passait-il ensuite ? Probablement des choses moins
scandaleuses qu’on pourrait le supposer, mais dont l’attrait se doublait de
toute cette mise en scène savante qui les enveloppait. Essayons de soulever un
coin du voile.
On voit le palais de la courtisane, orné dès le seuil des plus
précieuses mosaïques. Des Nubiens muets au torse lisse sont étagés sur les
degrés du péristyle et tiennent au-dessus de leur tête des globes d’amiante
étincelants qui projettent leur vive clarté jusque dans la rue. Les jardins
eux-mêmes sont remplis de ces lampadaires vivants dont s’illuminent les
feuillages ; des jets d’eau parfumés irisent l’air de leurs gerbes
multicolores et retombent dans des vasques de bronze où des Naïades renversées
bombent leurs ventres ruisselants. Un silence mystérieux, tel celui d’un temple
que baigne le clair de lune, plane sur toute la demeure ; la terrasse qui
domine la mer est entièrement sombre sous son vélum de pourpre ; seule une
statue de marbre d’une éblouissante blancheur marque cette place de sa nudité
sacrée.
Pour entrer cette nuit chez Phryné, il faut prononcer une formule
convenue d’avance. L’esclave qui se tient en haut des degrés incline la tête et
reçoit les secrètes paroles ; alors un autre esclave écarte la draperie
qui masque la première salle. Là c’est encore du silence et du mystère. Entre
les colonnes peintes de fines arabesques, d’énormes brûle-parfums simulant des
bêtes bizarres laissent échapper de leurs flancs la fumée des aromates. Ces
odeurs lourdes prennent à la gorge et y déposent une irritante âcreté. Mais
plus loin ce sont des roses effeuillées en masse qui couvrent la
mosaïque ; et voici qu’une musique éthérée, fragile, qui semble provenir
d’instruments de cristal, mais dont le rythme est une morsure, s’élève peu à
peu comme un spasme ou comme un sanglot. C’est Marsyas exhalant son dernier
souffle ; c’est l’âme douloureuse et sensuelle, passionnée et vibrante, de
l’homme-artiste déchirée par les griffes jalouses du dieu. Duel antique
renouvelé sans cesse ! Les hôtes de Phryné, cette nuit, goûteront, avec
les plaisirs d’un spectacle voluptueux, l’angoisse éternelle de la vie qui veut
rompre ses entraves et réaliser ses forces secrètes.
A mesure qu’on avance, plus d’obscurité se fait dans les salles où
d’habitude on circule librement parmi les rires et la clarté. La dernière,
transformée en sanctuaire et tendue de draperies écarlates, est éclairée
seulement par une unique lampe pendue à la voûte ; et derrière cette
lampe, sur un trône, Phryné est assise comme une idole abyssine ; ses
épaules, ses seins sont surchargés de pierreries ; son visage étroit, dans
lequel ses yeux verdâtres brillent comme des gemmes, est entouré d’une
bandelette de pourpre ; on ne voit pas ses cheveux ; on ne voit pas
son corps, qui disparaît sous des étoffes précieuses ; seuls, ses pieds
nus, rejoints sur un escabeau, révèlent la beauté pâle de sa chair. Et son
immobilité est telle, si hiératique est le geste de ses bras joints aux deux
chambranles du trône, qu’on la croirait habitée déjà par la majesté divine.
Les affiliés, dans leurs robes de femme, se sont placés autour
d’elle. Ils sont debout et quelques-uns appuient leurs épaules aux grandes
urnes de porphyre où s’enlacent des serpents d’or ; un peu de tremblement
les agite ; ils savent que devant cette Cotytto vivante, resplendissante
de filigranes et de joyaux, devant cette déesse dont la beauté restera voilée
pour eux jusqu’à la fin, toute une cohorte légère et lascive de jeunes filles
vêtues de cyclas transparentes va venir danser les figures sacrées. Et comme la
musique s’anime, comme les voix humaines se mêlent aux accords stridents des
harpes, tout à coup, avec des guirlandes et des flambeaux, elles entrent, les
jeunes danseuses, exaltées, sauvages et déjà possédées de la fureur divine. Ce
sont presque des enfants, mais ce ne sont plus des vierges ; elles savent
tout de l’amour et du désir ; leur chevelure ronde et courte, pareille à
celle des éphèbes, boucle sur leur cou ; leurs épaules sont étroites, et
leurs seins si menus qu’on dirait des églantines en fleur ; mais dans
leurs reins souples, dans le balancement de leurs hanches bientôt nubiles, la
volupté couve comme un feu ; et leurs mains expertes, en se passant les
flambeaux, en nouant et dénouant les guirlandes, s’attouchent, légères, et font
courir entre elles le fluide frémissant de la vie. Encore un tournoiement, et
les jeunes corps enlacés essaieront des pâmoisons vaines ; les flambeaux éteints
seront jetés sur le sol, les guirlandes foulées aux pieds exhaleront l’odeur
amère des fleurs blessées. C’est l’instant où dans les véritables mystères de
la Cotytto phrygienne on prononçait la formule sacramentelle : « Il
est temps d’introduire les hommes. » Mais chez Phryné, sans doute, on se
contente des gestes rituels, de la musique et des parfums. Le fond de
sauvagerie brutale, d’exaspération frénétique, dont sont faites les religions
asiatiques, ne saurait convenir à l’eurythmie athénienne. Ici c’est un
spectacle, rien de plus sans doute, l’imitation élégante des plus formidables
mystères, parce qu’il plaît à la courtisane d’être adorée.
Cependant, les portes ont été ouvertes sur la clarté des
jardins ; Phryné est descendue de son trône pour monter sur une chaise à
dossier élevé que portent les quatre plus jeunes des Baptes ; et le
cortège s’organise à travers les allées profondes jusqu’à un reposoir, dont le
dôme ajouré, fait de fleurs de népenthès tressées ensemble, est surmonté d’un
phalle d’ivoire et d’or. Le symbole primitif, entouré de torches luisantes,
rayonne comme un phare au-dessus de tout ce qui se meut, de tout ce qui
s’agite, de tout ce qui se balance dans ces jardins parfumés. Et la courtisane,
placée au centre du dôme comme la Cotytto impudique, semble porter ainsi sur
son front le signe de sa victoire sur le monde. Elle est le principe féminin
divinisé ;elle est l’attrait souverain, la force profonde, la Nature
passive en qui se renouvelle sans cesse la vie ; – et ce symbole sur
le front glorieux d’une idole marque le règne de la Femme que toutes les
théologies antiques ont annoncé. Devant Phryné, les petites danseuses aux
chevelures rondes font brûler maintenant les larmes d’ambre et de myrrhe ;
d’un geste rapide, leurs corps frêles penchés sous la cyclas transparente,
elles élèvent et abaissent les encensoirs, dont les chaînettes de métal font un
bruit susurrant et doux. Mais la musique, cachée dans les bosquets de
térébinthes, couvre ce glissant murmure, et des voix aiguës d’adolescents dont
on ne voit pas les visages, des voix androgynes où passe une poignante
inquiétude, montent, montent dans la nuit, clament éperdument les strophes de
l’hymne mystique. Les Baptes sont secoués d’un frisson qui agite sur eux les
plis de leurs robes de femme ; dans les mains des jeunes filles les
encensoirs ont frémi. Seule, Phryné n’a point bougé ; pas un émoi n’a
dérangé l’harmonie de sa face admirable ; elle boit l’encens, elle reçoit
dans ses oreilles, jusqu’au coeur, les phrases de l’adoration. Elle jouit de sa
beauté, d’elle-même, de sa propre gloire. Et ce grand désir mâle, épandu dans
les feuillages, elle le sent passer à travers sa chair sans en être troublée
– car elle se sait invincible.
VII
On peut supposer qu’Athènes devait être ce qu’on appellerait de nos
jours une ville de cancans. Tout s’y savait, tout s’y répétait dans le cercle
de la société relativement restreint, – le gros de la population se composant
de marchands, d’artisans et d’esclaves. Dans ce cercle où se retrouvaient les
mêmes femmes, les mêmes magistrats, la même bourgeoisie riche, la même
aristocratie qui tenait le haut du pavé et fournissait à la ville ses
chevaliers, la célébrité de Phryné était rapidement devenue un objet de
scandale. Jamais encore une courtisane, depuis la fameuse Aspasie, n’avait
occupé à ce point l’opinion publique ; mais Aspasie s’était vite adaptée
aux éléments de cette cité complaisante, tandis que celle qu’on appelait la
Thespienne, l’Aphrodite, la Charybde, affectait de mépriser Athènes, sa vie,
ses moeurs, son langage. Jamais elle ne s’était mêlée au frémissement de la vie
populaire. Elle ne donnait même pas au peuple l’aumône de sa beauté, comme les
autres hétaïres qui, par métier autant que par vanité féminine, recherchaient
toutes les occasions d’être admirées. Pour la voir, il fallait pénétrer dans
son palais, dont elle avait fait une sorte de hiéron accessible seulement à
quelques adeptes. De plus en plus son existence devenait, secrète, fermée,
légendaire...
Et naturellement les insinuations perfides allaient leur train. Une
jalousie sourde, enfiévrée, animait contre elle toutes les Athéniennes de la
haute classe. On ne lui pardonnait pas cette auréole de mystère dont elle avait
réussi à s’entourer et qui attirait les hommes à elle, comme les phalènes clans
la nuit vont à la lumière. Qu’elle fût une pornée, une marchande de caresses,
cela n’était rien ; les honnêtes femmes étaient habituées à cette
concurrence vénale qui leur assurait d’heureux loisirs. Mais qu’elle exerçât un
tel prestige, qu’elle fût admirée au point d’enlever à ces mêmes femmes les
hommages discrets auxquels elles étaient habituées, cela était trop fort, cela
ne pouvait être toléré, et l’on attendait une occasion de faire tomber de son
piédestal cette idole au dangereux sourire.
L’affaire des thiases fut sans doute le point de départ de la
persécution dont Phryné allait être l’objet, et que les historiens placent dans
le cours de la cent treizième olympiade. Vers la même époque, Praxitèle, avant
de partir pour la Carie, où il devait sculpter l’un des quatre côtés du tombeau
du roi Mausole, avait offert au temple de Delphes la statue de sa
maîtresse ; et cette belle image nue, coulée dans le bronze, portait au
socle cette inscription tracée de la main du maître : « Celle-ci est
Phryné la Thespienne, fille d’Epicleus ». Ainsi le délit était
flagrant : Phryné ne se contentait pas de se faire adorer en secret chez
elle ; il lui fallait un culte public ; une vénération unanime ;
la courtisane usurpait les prérogatives de la divinité. Les Athéniennes
tenaient leur vengeance. Il leur manquait un porte-parole ; elles eurent
bientôt fait de le trouver.
C’était un de ces personnages rampants et habiles, comme il en
existe partout. Il se nommait Euthias et exerçait la profession vague de rhéteur.
Il rassembla toutes les charges qu’on pouvait relever contre la
Thespienne ; elles se résumaient en une seule : le crime d’impiété.
Quelques auteurs ont prétendu qu’on y joignit une inculpation
d’assassinat ; mais aucune trace de cette prévention n’est demeurée dans
les fragments de la plaidoirie magistrale qu’Hypéride prononça à cette
occasion.
D’ailleurs le crime d’impiété était alors le plus grave de
tous : manquer aux dieux semblait bien plus coupable qu’attenter à la vie
humaine. Socrate avait été condamné à boire la ciguë à la suite d’une
accusation semblable ; une courtisane mériterait-elle plus de pitié que le
célèbre. philosophe ? Les Athéniennes, accrochées à la simarre d’Euthias,
soufflaient dans son âme leur haine et leur soif d’être vengées : il
fallait attaquer Phryné, la citer devant le tribunal des héliastes ;
qu’elle meure, qu’on la condamne elle aussi au poison, celle qui empoisonnait
les hommes de son venin corrupteur ! Les épouses des héliastes elles-mêmes
s’étaient jointes à cette ligue ; ainsi la solidarité féminine, qui un
siècle auparavant avait inspiré au grand Aristophane l’ironique comédie de
Lysistrata, retrouvait une fois de plus sa toute-puissance.
Comment Phryné fut-elle avertie du complot qui se tramait coutre sa
vie ? C’est ce que l’Histoire ne nous dit point. Peut-être en eut-elle le
pressentiment secret ; peut-être aussi parmi les membres de la thiase qui
venaient célébrer chez elle les mystères de Cotytto se trouva-t-il un adorateur
plus fervent que les autres qui se douta du péril et qui l’en prévint ? Le
plus probable, c’est que l’accusation la surprit dans la plus parfaite
quiétude ; et tout de suite elle dut songer à chercher un défenseur.
Démosthène, qui vivait encore, avait formé toute une génération d’avocats brillants,
audacieux, savants dans l’art de bien dire et que n’effrayait pas le
scandale ; avant de se jeter dans la tourmente politique qui avait fini
par le conduire à l’exil, il s’était entouré de cette pléiade de jeunes
orateurs élevés à son école et dont on disait dans Athènes qu’ils étaient ses
fils par l’esprit. Ce fut à l’un de ces maîtres éprouvés que Phryné résolut de
s’adresser pour lui confier le soin de disputer sa vie à la sévérité des
héliastes. Celui dont elle fit choix s’illustre alors dans le plus vif éclat de
sa renommée ; c’était lui que la République avait désigné pour défendre
ses prétentions sur l’île de Délos ; Cicéron, dans son énumération des
grands orateurs grecs, le place presque au même rang que Démosthène ;
enfin, tout jeune, il avait suivi les leçons de Platon sous les ombrages de
l’Académie, empreinte ineffaçable qui lui faisait mêler à la nervosité de son
verbe le grand souffle des idées métaphysiques. Ces raisons sans doute
déterminèrent le choix de Phryné. Cependant il dut y en avoir de plus
secrètes : Hypéride, malgré la noblesse de son esprit, était de moeurs
dissolues ; il avait chassé de sa maison de ville son fils Glaucippe pour
y installer Myrrhine, « courtisane de grande dépense », assure
Athénée ; il avait en outre une seconde maîtresse au Pirée, nommée
Aristagore, et une troisième à Éleusis, Phila, qu’il avait achetée très cher à
l’un de ces marchands de jeunes filles qui faisaient de si bonnes affaires en
Ionie. Avait-il déjà obtenu les faveurs de la grande hétaïre quand il accepta
de plaider pour elle, ou se promit-elle à lui comme suprême récompense ?
Le cas est douteux. Mais on rapporte que Myrrhine, dans un bel élan de
générosité, quand elle sut Phryné accusée, cou-rut vers elle et lui proposa de
lui prêter son amant. « C’est déjà fait ! » répondit Phryné. Et
les deux femmes, sans jalousie, s’embrassèrent. – Magnanimité antique !
Le matin où la Thespienne comparut devant les héliastes, la foule
était si grande dans toutes les rues de la ville qui menaient au tribunal qu’on
se serait cru au jour des Panathénées. Ce tribunal, -– on le sait, se tenait en
plein air, sur une place publique appelée Hélaïa, et orientée au soleil levant,
d’où le nom de ses membres, héliastes (ensoleillés). On a dit que c’était des
vieillards faciles à corrompre. Pourquoi ? C’était des hommes pris au sort
parmi les citoyens des classes libres, qui devaient avoir au moins trente ans
et qui ne recevaient d’autre salaire qu’un jeton de présence, le symbolon,
en échange duquel on leur donnait le triobole institué autrefois par
Clisthène. En somme, ils formaient une sorte de jury très solennel, dont les
membres pouvaient atteindre au chiffre respectable de six mille. Mais ils ne
siégeaient pas tous ensemble ; ils étaient répartis entre les différents
dèmes et appelés en nombre plus ou moins grand suivant l’importance de
l’affaire qu’on leur soumettait. Pour juger Socrate, ils avaient été cinq cent
cinquante-neuf, sur lesquels une majorité de six voix seulement avait condamné
le philosophe ; pour juger Phryné, ils devaient être plus nombreux encore,
si l’on considère l’émotion immense qu’avait soulevée dans Athènes la mise en
accusation de la courtisane. On savait que le réquisitoire d’Euthias ne
l’épargnait point ; on s’attendait à des révélations sensationnelles sur
sa vie. Ses partisans et ses ennemis se battaient déjà dans les carrefours.
Dans les échoppes de la Deixma aussi bien que dans l’élégant quartier du
Dromos, on se passionnait pour cette cause célèbre.
Cependant Phryné était descendue de sa litière, enveloppée comme
d’habitude du long vêtement plissé qui couvrait jusqu’à ses cheveux. Hypéride
se tenait à ses côtés, et derrière elle on pouvait reconnaître dans la foule
les autres hétaïres fameuses, Myrrhine, Glycère, Bacchis et jusqu’aux dictériades
du port, venues là pour soutenir et encourager leur illustre compagne. C’était
la protestation des ardentes prêtresses de Vénus contre ces femmes sévères, ces
bourgeoises au coeur exigeant qui, en attaquant Phryné, espéraient détruire du
même coup le prestige de toute la corporation des pornées. Et l’enjeu de cette
partie mémorable, c’était toujours l’éternel Éros charnel, le dieu des larmes
et des sourires, l’inconstant, le cruel, l’abominable et nécessaire Éros. Des
frissons couraient dans l’assistance ; des parfums précieux se mêlaient à
l’odeur grasse des hommes du peuple ; et les héliastes, revêtus de leurs
longues robes de pourpre, assis sur des escabeaux de granit, recevaient sur
leurs visages fermés l’or du soleil matinal.
Euthias s’expliqua le premier : Il accusa Phryné
« d’avoir réuni chez elle des thiases illicites d’hommes et de
femmes, d’avoir corrompu la jeunesse et insulté les dieux en se faisant
adorer ». En outre, elle était convaincue d’avoir prononcé ce
blasphème : « Si tout le peuple d’Athènes était un seul homme, et si
Phryné s’offrait à lui, il n’hésiterait pas à livrer la République pour un
baiser de Phryné. »
Cet acte d’accusation d’Euthias devait être singulièrement
habile ; certains traités de rhétorique le citent encore comme un
chef-d’oeuvre du genre. Mais le plaidoyer d’Hypéride, préparé longtemps à
l’avance, fut assurément l’un des plus beaux dont aient retenti les échos de
l’Hélaïa. Le grand avocat athénien n’essaya point de nier les faits reprochés à
sa cliente ; il s’attacha seulement à montrer qu’elle n’était point aussi
coupable qu’en témoignaient les apparences – et même qu’elle n’était pas
coupable du tout. Puisque la loi admettait, protégeait les courtisanes, ne fallait-il
pas leur laisser le libre exercice de leur profession ? S’était-elle fait
adorer vraiment selon les formes rituelles, et avait-elle réuni dans son palais
des thiases illicites, ou plutôt n’était-ce pas là un jeu charmant, un
spectacle d’art et de beauté ? Hypéride en appelait à tous les hommes de
la ville qui avaient été assez heureux pour être admis aux fêtes de la
Thespienne : aucun certes n’oserait dire qu’elle avait manqué ni à la
République, ni aux dieux.
L’avocat parlait lentement, sans faire de gestes, selon l’habitude
des orateurs de la grande école qui méprisaient les effets faciles et
cherchaient avant tout l’élégance et la mesure. On sait que Périclès, dont
l’éloquence pourtant était irrésistible, prononçait tous ses discours le bras enveloppé
dans les plis de son manteau ; le démagogue Cléon avait été le premier à
quitter cette attitude classique pour « tenir la main dehors », selon
l’expression pittoresque de son biographe ; or, le peuple, ‘à cause de
cela ; avait flétri le démagogue du surnom de Singe ! Sous ce ciel
pur, dans cette lumière éclatante, tout prenait une puissance de vibration qui
nous est inconnue ; et, comme le remarque M. Boutmy, « l’Athénien
discernait vingt impressions là où nous n’en éprouvons qu’une ». Hypéride,
fidèle à la belle tradition des maîtres, défendait donc Phryné avec la seule
puissance de son verbe ; mais le jury des héliastes, malgré tant
d’éloquence et de chaleur, semblait indécis. Ce qu’il ne pardonnait pas à
l’hétaïre, c’était l’imprudente parole qu’elle avait dite, que beaucoup avaient
entendue : « Si tout le peuple d’Athènes était un seul homme, et si
Phryné s’offrait à lui, il n’hésiterait pas à livrer la République pour un
baiser de Phryné. » Tout à l’heure, quand Euthias avait répété cette
assertion impie, il y avait eu des murmures dans la foule. Et Hypéride, habitué
à ces remous des consciences, avait senti que ce serait là l’écueil sur lequel
viendrait échouer son effort... Pourtant il fallait sauver Phryné !...
Elle était là, palpitante, près de lui, et tout enveloppée de ses voiles. Alors
il eut une inspiration soudaine, un mouvement irraisonné et instinctif qui fut
sublime : il la poussa devant les juges, et, écartant les plis de
l’himation, il découvrit l’admirable gorge de la courtisane, ces deux seins
glorieux sur lesquels le soleil – tel l’aveugle archer d’Hésiode – brisait
en vain ses flèches d’or.
Plusieurs auteurs ont raconté qu’Hypéride avait mis Phryné
complètement nue devant ses juges et cette légende inspira au peintre Gérôme un
érotique et naïf tableau. Contentons-nous du récit que nous a laissé Athénée.
Ce récit s’accorde d’ailleurs avec ce que l’on sait du costume des femmes
grecques, qui se composait toujours de trois parties : la tunique de
dessous, ou le chiton, qui laissait libres les épaules et les bras ; la
tunique de dessus, généralement attachée à la taille par une ceinture, mais dont
la forme variait selon les villes et les caprices de la mode ; enfin le
grand manteau souple, péplum ou himation, dont on se drapait à son gré, afin de
se protéger contre la poussière et le vent. Pour mettre Phryné nue, il eût
fallu qu’Hypéride non seulement arrachât l’himation, mais encore qu’il déchirât
ou défît entièrement la tunique de dessus et le chiton. On ne voit pas beaucoup
ce déshabillage devant le sévère tribunal qui siégeait sur l’Hélaïa !
Quant à prétendre que cet argument suprême était préparé d’avance, il faudrait
pour cela bien peu connaître l’esprit du temps, et ce génie de la Modération
qui dans l’Attique avait partout ses autels.
Le geste d’Hypéride avait sauvé Phryné : devant la beauté de
cette gorge de femme, un respect religieux avait saisi les héliastes. Ces seins
nus, gonflés de sève et blancs comme le lait, ces deux seins jumeaux, c’était
la source sacrée, la fontaine de vie où s’alimentent les générations humaines.
Chaste et divine, la Thespienne leur apparut cette minute comme une auguste
image de la maternité et de l’amour ; elle n’était plus la courtisane,
que, nue, ils eussent condamnée peut-être. « Et ils la laissèrent aller,
dit Athénée, sans lui infliger aucune peine » ; tandis que la foule,
ramassant des pierres sur l’Hélaïa, cherchait à en lapider Euthias, qui fuyait
le long des portiques.
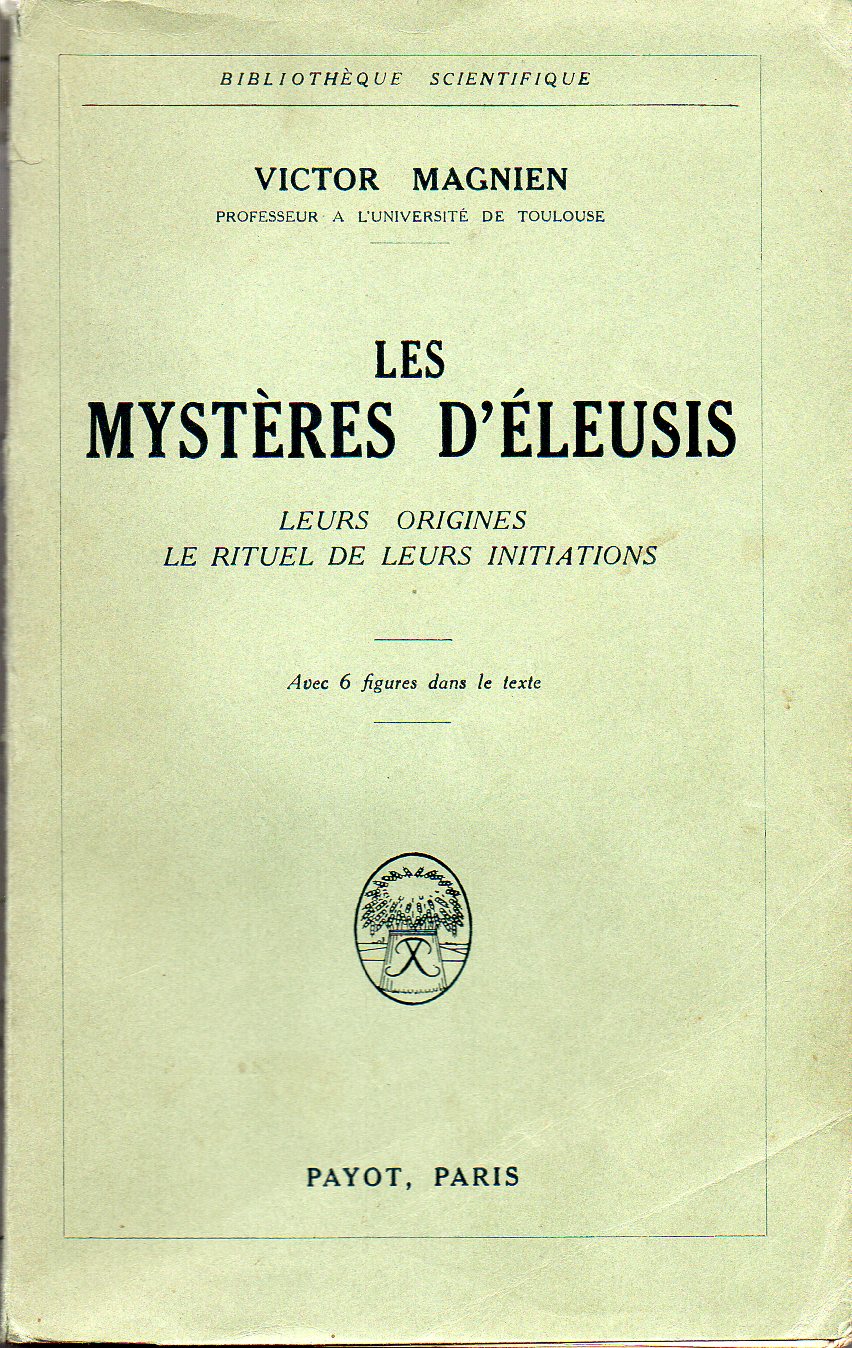
Suivant les anciens (3500 ans avant JC), la nature aime à se cacher, et la vérité ne s'aperçoit pas sans effort et sans travail. Ceux qui ont trouvé cette vérité, ne doivent pas la dévoiler trop facilement aux autres et l'exprimer en termes trop clairs. Les initiés aux petits et grands Mystères suivent des grades comme la Franc-maçonnerie de nos jours qui se veut héritière de ce passé. Il existe aujourd'hui, une loge qui n'a de comptes à rendre à personne, et qui se situe au dessus de toutes les loges et qui prépare le chemin que les autres devront suivre sans que personne ne puisse s'y opposer et dont l'initiation suprême est faite par des Dieux. La plupart des historiens modernes admettent que les Mystères d'Éleusis, venant de Crète et d’Égypte avant de se transmettre en Phrygie, à Samotrace puis à Athènes, ou rituels d'initiation préparatifs à la mort, à la sagesse, et à une religion, à des Dieux, à leurs cultes et à leurs fêtes, ont subit une profonde transformation au septième siècle avant Jésus Christ. Osiris est assimilé à Dionysos, Isis à Déméter et à Perséphone sa fille. Zeus eut des enfants de sa mère Rhéa et de sa fille Déméter. L'âme est un composé du corps humain, elle devient impure quand elle est associée à un corps, et lorsque ce dernier meurt, elle va aux enfers chez Hadès pour expier, se purifier et rejeter les souillures du corps, avant de rejoindre un corps nouveau. L'âme et la pensée sont différentes. Un des cultes était voué à Aphrodite et Phriné, pour échapper à son destin, a été récupérée par les prêtres d'Éleusis, pour s'adonner au culte de la déesse.
VIII
Ce fut peu de temps après ces événements que Phryné, désormais à
l’abri des persécutions, fut amenée à figurer dans la pompe sacrée d’Éleusis.
On a dit que les héliastes, après l’avoir acquittée, s’étaient ravisés soudain,
et, comme pénitence, lui avaient imposé d’aller se baigner chaque année aux
yeux du peuple, pendant la célébration des grands mystères. Cette fable n’a
même pas besoin d’être réfutée, et on n’en doit retenir que le fait principal :
il est certain que Phryné se baigna devant le peuple dans les flots bleus du
golfe Saronique ; mais une fois seulement, et il est intéressant de
chercher comment cette chose surprenante put se produire.
A ce moment, les grands mystères d’Éleusis, qui pendant de longs
siècles avaient attiré sur ce point du monde civilisé un concours immense
d’étrangers, commençaient à perdre un peu de leur éclat. Si le nombre des
initiés était toujours aussi important, il n’y avait plus dans la foule le même
enthousiasme ; et la foi languissante avait besoin d’être ranimée. Ce
n’était pas en vain que les philosophes ioniens, que les penseurs de tous les
pays avaient émis leurs théories subversives ; sans pénétrer la masse
profonde du peuple, elles flottaient clans l’air, ces idées ; elles y
répandaient un ferment libérateur. Depuis longtemps l’élite intellectuelle de
la Grèce ne croyait plus qu’à un Dieu unique ; et c’était
vraisemblablement cette doctrine primitivement enseignée en Égypte que l’on
conservait à Éleusis, où les grandes traditions de la sagesse isiaque se
trouvaient presque directement transplantées. Isis, là-bas, dans le hiéron de
Saïs, c’était ici Déméter, la Nature éternelle ; toutes deux décrivaient
le même cycle et symbolisaient les mêmes phénomènes d’ordre physique :
mais, à travers tous ces voiles, toutes ces allégories, toutes ces légendes,
une croyance secrète existait qui ramenait tout à un seul principe :
l’Intelligence démiurgique, l’Esprit infini, qui a donné à l’Univers sa forme,
et dont les divers attributs ont été personnifiés pour le vulgaire.
Le peuple, s’il n’avait pas encore discerné cette vérité, hésitait
entre la crédulité et le doute. De même que les mages d’Égypte, les pontifes
d’Éleusis s’attachaient à un ésotérisme intransigeant ; et la multitude
des fidèles, troupeau docile, devait se contenter des processions où figuraient
les signes sacrés, des chants liturgiques dont on répétait les paroles sans les
comprendre, de l’odeur de l’encens et de la lueur fumeuse des torches. Puis sur
tout cela s’était greffé l’élément commercial, qui avait presque absorbé l’idée
primitive. Pendant les neuf jours que durait la célébration des mystères,
depuis Athènes jusqu’à Éleusis, c’est-à-dire sur une longueur de soixante-dix
stades (seize kilomètres environ), c’était une succession non interrompue de
boutiques en plein air, d’étalages et de revendeurs ambulants qui envahissaient
jusqu’aux degrés de la ville sainte ; et souvent les affaires les plus
sérieuses se tramaient sous le couvert des pratiques dévotes. Le Christ n’était
pas encore venu, dont le geste souverain devait chasser – pour trop peu de
temps, hélas ! – les marchands du temple.
Athènes, dès les jours les plus ancien, avait eu la juridiction
suprême sur ces fêtes devenues si productives. C’était l’archonte éponyme qui,
de concert avec l’hiérophante d’Éleusis, en réglait tous les détails
extérieurs. Ordinairement, le cérémonial comprenait, outre la grande procession
de la déesse qui parcourait le rivage, des jeux athlétiques, des combats de
coqs, des tableaux vivants, et enfin le simulacre du mariage mystique entre la
femme de l’archonte et l’hiérophante qui, transportés sur un char orné de
bluets et de coquelicots, allaient jeter dans les sillons de la plaine de Thria
le grain de blé que Déméter devait faire fructifier en moisson abondante pour
le bien de la patrie attique ; – tel le doge, aux beaux temps de la
République vénitienne, jetait son anneau à la mer. Saint Épiphane, qui fait
remonter l’établissement de la pompe éleusinienne à deux mille ans avant
Jésus-Christ, ajoute qu’on y faisait figurer des femmes entièrement nues. Tout
ne se passait donc pas avec autant de décence que plusieurs écrivains modernes
se sont plu à l’assurer. Une effervescence très grande régnait parmi l’assistance :
Tertullien raconte (car il est à remarquer que les Pères de l’Église se sont
presque tous occupés de ces mystères) que les femmes riches, d’Athènes se
rendaient à Éleusis dans des chars attelés de deux chevaux, et que, quand elles
se rencontraient, « elles s’injuriaient et s’accablaient mutuellement de
sarcasmes ». Pendant ces neufs jours, la fureur mystique devait secouer
toute cette multitude.
On peut dès lors supposer, sans manquer de respect à l’idée
antique, que l’archonte athénien, voulant donner un lustre nouveau aux fêtes
d’Éleusis et ranimer la ferveur des assistants venus de partout, demanda à
Phryné d’y figurer et de se baigner dans le golfe au moment où se déroulerait
sur le rivage la procession de Déméter. Généralement, cette procession avait
lieu le deuxième jour des fêtes. Le soleil de septembre caressait doucement les
vagues pressées dans l’anse étroite et les sillons de cette terre fertile, où
la déesse, secouant les plis de sa robe, avait semé le premier grain de blé,
geste auguste, dont chaque année on faisait mémoire. Quelle lumière vibrante,
azurée, fertile, glissait sur la plaine et sur la mer, et donnait à toutes
choses la légèreté de la vie ! Quel transparent éther faisait resplendir
sur la colline sainte les deux temples, les propylées de marbre, la polychromie
des statues et l’or amolli qui coulait sur les épaules de Déméter, vêtue de
cette gloire comme d’une seconde moisson ! Toutes ces couleurs, toutes ces
richesses se fondaient pour former le plus harmonieux des tableaux ; mais
formidables, les cris, les trépignements de la foule trouaient la lumière,
ébranlaient presque sur leurs assises les chefs-d’oeuvre créés parles purs
artistes. Io ! Io ! Déméter... Enfin les portes de la cella se sont
ouvertes – cette cella que Strabon nous dépeint aussi vaste qu’un
théâtre – et la statue de la déesse, enlevée par dix jeunes dadouques,
oscille au-dessus des fronts.
Alors s’organise la procession sainte... L’hiérophante, suivi de
tout son collège de prêtres, marche le premier ; puis l’archonte et les
autres dignitaires d’Éleusis et d’Athènes, puis le blanc cortège des initiés
nouveaux vêtus de leur robe de lin. Ils ont une clef suspendue à leur ceinture,
emblème du secret qu’ils doivent garder ; leur silence forme un saisissant
contraste avec le tumulte effroyable que traîne dans ses plis la pompe
démétrienne, s’acheminant vers la mer. Sur la terrasse qui est jetée comme un
pont entre les deux temples, toute une multitude encore se tient pressée. C’est
la fin du jour ; maintenant le soleil prend au couchant les nuances
rutilantes de l’automne, et l’azur du ciel est traversé d’une infinité de
petites raies violettes qui semblent fuir et renaître dans un perpétuel
vacillement ; entre ses falaises, l’anse étroite d’Éleusis se magnifie
d’une telle clarté que les oiseaux, attirés par ce mirage, viennent voler en
cercles pressés au ras des flots ; plus loin, dans le golfe Saronique, des
bateaux nombreux, comme d’autres ailes immobiles, attendent le retour des
passagers qu’ils ont versés au rivage ; et Salamine, île de pourpre et de
langueur, resplendit comme une large corbeille où s’épanouit la légère
frondaison des lauriers-roses. Les souvenirs émouvants de l’histoire, la gloire
de Thémistocle refoulant à cette place l’invasion médique, l’inoubliable
prestige du génie grec, tout cela se mêle à l’enthousiasme religieux, et
oppresse plus fort les poitrines. – Non, ce peuple n’a pas encore perdu sa
foi ! – ... Mais voici que, tout à coup, des vagues molles et bleues,
de l’écume floconneuse, une forme blanche et nue s’élève, une chevelure
ruisselante, un visage aux traits divins, un corps lisse et pur qu’un furtif
rayon caresse. Et, debout sur le sable. du rivage, souriante et tordant ses
lourds cheveux, Phryné apparaît, quand défile le long cortège. « L’Anadyomène !
C’est l’Anadyomène ! » crient des milliers de bouches ardentes.
« C’est Aphrodite la bienheureuse, née du sein fécond de la mer, qui est
venue joindre ses grâces à celles de Déméter fertile ! » Les pèlerins
tendent vers elle leurs bras. Et quelques-uns, prosternés sur le sable tiède,
prient et adorent...
IX
Parmi la foule cosmopolite à qui la beauté de Phryné avait été
ainsi révélée se trouvait le peintre Apelle. Il était venu là en spectateur
sans doute, pour jouir des tableaux incomparables qu’offrait la pompe sacrée
d’Éleusis. Il était venu, indifférent, blasé, traînant le poids de sa propre
gloire – et il en repartait avec une inspiration nouvelle, tourmenté par
l’obsession d’un chef-d’oeuvre.
On sait qu’à tort ou à raison les Grecs, qui avaient donné à Apelle
le titre de prince de la peinture, se vantaient d’être les inventeurs de cet
art. Évidemment il ne s’agissait point de la forme décorative qui, dès les
temps les plus anciens, n’était que l’accompagnement de la pierre et du marbre ;
mais de la peinture libre, délivrée des exigences des sculpteurs et des
architectes, et qui a en elle son propre objet. Avec quel mépris les
contemporains d’Apelle parlaient des Égyptiens, ces grands ancêtres auxquels
cependant ils avaient emprunté beaucoup. « L’amère et mélancolique Égypte,
disaient-ils où rien ne change, où tout est immuable. » Et Platon constatait que cet art, exercé, au pays des Pharaons
depuis tant de siècles, « n’avait rien produit de meilleur à la fin qu’au
commencement ». C’était toujours les mêmes types répétés, les mêmes
procédés presque mécaniques, qui permettaient à l’artiste de travailler très
rapidement et comme « de pratique » – nous dirions « de
chic » aujourd’hui – au lieu de s’astreindre à l’étude patiente du
modèle.
Le modèle vivant, le modèle humain, voilà le talisman qui devait
affranchir l’oeil du peintre des visions conventionnelles ; voilà ce qui,
dès le cinquième siècle, avait fait la renommée de Polygnote, le premier
d’entre les artistes grecs qui aient reproduit directement la nature. Dans ces
immenses fresques du Poecile d’Athènes où Pline assure que figuraient plus de
deux cents personnages, et que Pausanias a décrites si minutieusement, il avait
cherché pour chacune de ses figures le type correspondant le mieux à la
réalité. Et, s’il embellissait cette réalité, s’il l’idéalisait par la noblesse
de l’expression et du geste, du moins la suivait-il fidèlement. Comme le grand
Homère qui fut l’inspirateur épique de ces fresques colossales, il aimait le
détail exact, la précision qui définit la vie. On assure qu’il demanda à la
soeur de l’illustre Cimon, la belle veuve Épinicie, de lui prêter ses traits
pour représenter Laodice dans cet épisode de l’Iliade que tout Grec
savait par coeur et apprenait dès le berceau à ses fils. De ce jour, la routine
aveugle était brisée, l’élan était donné à une nouvelle formule d’art. Bientôt
la peinture descendit des murailles ; et le tableau de chevalet, les
portraits, les paysages, les scènes d’histoire se multiplièrent, en même temps
que la technique se perfectionnait. Si rien n’est resté de ces oeuvres
innombrables, on sait du moins quels sont les maîtres qui les ont signées.
Personne ne dispute à Parrhasius l’honneur d’avoir tracé le premier
« canon » de la beauté, en écrivant son Traité sur la symétrie des
corps, dont il appliqua les règles dans sa Nourrice crétoise et dans
son Éducation d’Achille. Nul ne met en doute que Zeuxis ait trouvé « le
colorement des ombres », que son rival Apollodore avait vainement cherché
avant lui ; et qu’il établit les lois de la perspective, dont s’étaient
peu souciés jusque-là les artistes. La main de Zeuxis ! c’était
l’expression courante en Grèce pour désigner cette facture neuve et brillante,
cette science du clair-obscur, ce relief puissant qui constituaient la manière
personnelle du maître. Il fit école : de nombreux « conservatoires de
peinture » s’établirent dans toutes les villes de la Grèce, et selon l’usage,
seuls les hommes libres y furent admis. Ce n’était pas là, d’ailleurs, un
métier à la portée de tout le monde. Quintilien raconte qu’outre l’art du
dessin et de la couleur on y enseignait l’histoire, la poésie et la
philosophie ; tout cela coûtait très cher ; l’éducation d’un peintre
– c’est encore Quintilien qui le dit – revenait à une somme moyenne
de dix talents (cinquante-quatre mille francs). Il est vrai qu’ensuite la
gloire et les bénéfices compensaient ces premiers débours. Les peintres
« arrivés » étaient de grands seigneurs qui vivaient dans une
opulence sybaritaine et vendaient leurs toiles le prix qu’ils voulaient.
Parrhasius dédaignait de les faire payer, disant qu’il n’en trouverait jamais
leur véritable valeur ; d’après le véridique Plutarque, Nicias refusa pour
un de ses tableaux soixante talents (trois cent vingt-quatre mille francs), et
le Beau Bacchus d’Aristide se vendit cent talents (cinq cent quarante mille
francs). Quant à Zeuxis, il ne vendait point ses chefs-d’oeuvre, mais les
montrait pour de l’argent : c’est ainsi que l’admirable Hélène, qu’il
avait peinte pour la ville d’Agrigente en faisant poser devant lui les cinq
plus belles filles de cette cité, et dont il fit une réplique pour les
Athéniens, fut surnommée l’Hélène courtisane, en raison du tribut que devaient
payer tous ceux qui étaient admis à contempler sa beauté.
Mais on peut supposer que, malgré tant de progrès rapides, la
peinture restait encore ce qu’était la sculpture au temps de Phidias, un peu raide,
un peu primitive et tout enveloppée dans les liens de l’idée dogmatique.
L’expression morale y tenait plus de place que les grâces purement plastiques.
M. Bougot, dans la savante introduction dont il fait précéder la Galerie de
Philostrate l’Ancien, remarque qu’à cette époque ce qu’on demandait surtout aux
peintres, c’était « d’exprimer avec sincérité, soit par le jeu des
physionomies, soit par le geste des personnages, des sentiments conformes à
leur situation : l’âme, en un mot, voilà le sujet de leur préoccupation
unique ; un trait pour eux ne vaut que comme un signe ; et ce
signe, ils l’estimaient en proportion de sa justesse, de sa clarté, de sa
force. Aussi haut que l’on remonte, la critique ancienne divulgue cette
tendance. Que demande Socrate à Parrhasius, dans le fameux dialogue rapporté
par Xénophon ? De faire du visage le miroir de l’âme. Pourquoi
Aristote préférait-il Polygnote à Zeuxis ? Parce que, selon lui, Polygnote
avait bien représenté le caractère, tandis que la peinture de Zeuxis
était dépourvue de toute expression morale ».
Avec Apelle,
cette décadence, ou, si on l’aime mieux, cette révolution dans l’art
d’interpréter le modèle humain, était devenue définitive. Hardiment il avait
rompu avec les traditions du passé ; il avait dédaigné l’esthétique
ancienne qui prisait avant tout le beau idéal, pour ne chercher, lui, que le
beau physique, les contours impeccables des formes, la morbidesse de la chair
nue, et toute cette magie de la couleur, cette richesse de tons, qui devaient
faire de lui une sorte de Corrège ou de Raphaël antique. Auprès d’Alexandre le
Grand, qui l’avait attaché à sa personne, l’occasion lui était belle de
satisfaire son goût pour les réalités voluptueuses ; les maîtresses du
conquérant avaient ordre de lui servir tour à tour de modèles, et l’on dit même
que la plus belle de toutes, Campaspe, lui fut entièrement livrée. Ainsi le
peintre-courtisan était-il récompensé d’avoir représenté son protecteur dans
l’éclat de sa gloire, armé de la foudre comme Jupiter d’Olympe, et tourné de
façon à ce que le monde ne vît pas qu’il louchait d’un oeil et qu’il avait le
nez de travers.
Voici donc Apelle, en pleine possession de son génie, qui guette
Phryné, dont tous les désirs sont satisfaits. Osera-t-il lui offrir de l’or, à
elle qui ne sait plus où mettre ses richesses, ou son amour, à elle qui a été
tant aimée, ou seulement la vanité de devenir sous son pinceau la Cypris des
ondes violettes, elle, l’immortelle Aphrodite de Cnide que Praxitèle a fait
vivre dans le marbre ? Comment l’abordera-t-il, et par quels mots
touchera-t-il son coeur ? Jamais encore il n’a pénétré dans le palais
qu’elle habite. Athènes n’est pas la ville où s’attachent ses
préférences ; il n’y vient qu’en passant, lui qui a l’âme errante du
voyageur ; qui, de Cos où il est né, est allé vivre à Éphèse, à
Amphipolis ; qui a parcouru la mystérieuse Asie jusqu’au Gange, la dure
Afrique jusqu’aux Pyramides ; lui qui a pris un peu partout cette
sensibilité ondoyante et fugitive, qui se répand sur tant d’objets différents.
Il se souvient que naguère à Corinthe, auprès de la vasque bleue d’une
fontaine, il a vu venir une enfant de quinze ans, à demi-nue, qui tenait sa
cruche sur le sommet de ses cheveux noirs ! Il la prenait par la main et
l’emmenait avec lui à l’auberge voisine ; et, comme son compagnon de route
le plaisantait sur ce caprice insolite : « Ris tant que tu voudras,
lui répondait-il, dans trois ans d’ici cette petite sera la plus célèbre
hétaïre de Corinthe. » C’était Laïs. Et Laïs,
depuis, l’avait toujours reçu avec amitié. Mais Phryné, l’orgueilleuse,
l’impénétrable Phryné, le temps est passé où elle allait, elle aussi, puiser de
l’eau aux fontaines de sa contrée natale ; maintenant, pour obtenir ses
bonnes grâces, il faut longtemps attendre et quelquefois supplier en vain. Et,
malgré le renom immense dont il jouit, Apelle se sent inquiet, il craint de
voir lui échapper cet incomparable exemplaire de la beauté féminine.
Déjà le fond de son tableau est achevé ; il a peint « le
sourire innombrable de la mer », le soleil inondant les falaises
pentéliques, et, dans le lointain, le paysage de Salamine, qui semble une île
de rêve dont les dauphins caressent les bords. Mais le milieu du tableau est
vide ; car ni Campaspe, ni Laïs, ni aucune des femmes qu’il a rencontrées
et traduites ne pourrait rendre ce qu’il a aperçu sur la plage sacrée
d’Éleusis : l’Anadyomène nue et souriante, tordant sa chevelure comme une
gerbe d’épis dorés. C’est celle-là qu’il lui faut, c’est celle-là qu’il aura.
Un jour il va frapper à la porte de Phryné. L’esclave qui garde le seuil lui
demande ce qu’il veut. « Dis à ta maîtresse que c’est Apelle de Cos qui ne
peut finir sans elle le chef-d’oeuvre qu’il a commencé. » Alors Phryné
accourt ; elle consent. Elle installe chez elle l’artiste, dont elle ne
veut recevoir aucun présent.
Telle est l’anecdote, à peu près dans la
forme où l’ont contée les auteurs anciens. Elle est assez belle ainsi, et n’a
pas besoin d’être amplifiée ni commentée. Mais naturellement elle a servi de
prétexte à des gloses interminables, dont les moins ridicules ne sont pas
celles qui montrent Apelle devenu l’amant de l’hétaïre et profitant de ses richesses
pour vivre dans l’oisiveté. D’autres ont nié que Phryné ait servi de modèle
pour la Cypris Anadyomène, mettant ainsi en doute le récit de Quintilien,
d’Athénée et les témoignages du temps. Que Phryné ait été ou non la maîtresse
d’Apelle tandis qu’il était son hôte, cela importe peu. Quant à prétendre
qu’elle n’a point posé pour le plus grand chef-d’oeuvre de la peinture antique,
c’est aller non seulement contre les traditions établies, mais encore contre
toute vraisemblance. Qui donc aurait pu aider le peintre à fixer sur la toile
cette vision enchanteresse d’Éleusis, et prêter ses traits à la Vénus dont
Phryné était aux yeux de tous les Grecs l’incomparable modèle ? Relisons
cette épigramme de Julien d’Égypte dans l’Anthologie : « Cypris vient
de sortir du sein des flots. L’art d’Apelle a rempli les fonctions d’Ilithye.
Allons ! Tenez-vous à distance du tableau, de peur d’être mouillé par
l’eau qui ruisselle de la chevelure de la déesse. Si telle autrefois Cypris
s’est montrée toute nue au berger Pâris pour une pomme, c’est bien injustement
que Minerve a dévasté la ville de Troie. »
Cette admirable peinture, où l’allégorie, qui est un des caractères
les plus frappants de l’art antique, s’animait des vibrations de la vie, est
restée ineffaçable dans le souvenir des hommes, malgré qu’elle ait disparu tout
à fait – probable-ment dans cette tourmente barbare du cinquième siècle,
où sombrèrent tant de choses précieuses. Pline, qui l’avait vue, rapporte que
les habitants de Cos l’achetèrent d’abord pour la placer dans le temple
d’Esculape, et que plus tard ils la vendirent à Auguste moyennant un tribut
annuel de cent talents (cinq cent soixante mille francs), « quoique
l’injure du temps ait déjà endommagé l’œuvre du peintre ». Le César la mit
dans le sanctuaire de Vénus Genitrix à Rome. Depuis, on a perdu sa trace, et ce
sera un regret éternel pour l’humanité de ne pouvoir contempler cette page
unique. Quelques camées en pierre dure et le magnifique dessin que cite
Émeric-David et qui fut gravé par Bertole, semblent cependant être des copies
de l’Anadyomène d’Apelle.
Vieilli, le peintre, qui avait semé dans le monde tant de tableaux
de chevalet, tant de monochromes délicieux, tant de scènes d’histoire et de
légende qui ont été répétées aux époques de décadence et particulièrement dans
les peintures campaniennes ; vieilli, Apelle voulut, de sa main
défaillante, tracer une seconde image de la Cypris Anadyomène. La mort le prit
avant qu’il eût terminé son oeuvre – et personne après lui n’osa l’achever...
X
IcI s’arrête ce que nous savons d’authentique sur la grande
hétaïre. Si l’on en croit quelques récits de seconde main, elle continua à
protéger les artistes groupés autour d’elle, et fixa le type de presque toutes
les Vénus peintes ou sculptées que l’on fit de son temps. Mais il vint un
moment où les grâces de ce corps tant de fois déifié se fanèrent, où le beau et
pur visage offert à l’adoration des hommes se marqua des plis de la maturité.
C’est l’heure triste, comme l’automne qui s’effeuille, comme le crépuscule qui
noie de teintes livides l’occident :
Tu t’en iras,
Jeunesse,
Tu t’en iras, tenant
l’Amour entre tes bras.
Comment Phryné accepta-t-elle ce dramatique passage entre l’ultime rayonnement
de sa beauté et le déclin, si pénible à toutes les femmes et plus encore à
celles qui font le métier d’amoureuses ? Continua-t-elle à rechercher les
caresses des beaux éphèbes, telle Laïs de Corinthe, à qui un garçon boucher
devait offrir par dérision, sous un portique, un triobole de son corps
flétri ? Chercha-t-elle, ainsi que la prudente Aspasie, à s’embourgeoiser
dans les liens d’un mariage respectable ? Ni l’un, ni l’autre ; on
l’aurait su ! Le champ des suppositions est ouvert, et il a permis de s’y
avancer lentement et d’y élever la stèle enguirlandée de pâles violettes, où le
passant anonyme, curieux de connaître la fin des choses, trouvera l’épilogue de
la belle histoire de Phryné.
Le poète qui rêve d’elle et qui a consulté les Moires ne peut
admettre qu’elle se soit désintéressée trop vite des jeux inoubliables de
l’amour.
Il sait qu’elle y a mis tout son génie, tout son art, toute sa
perversité de femme. Si elle a réservé son coeur pour un seul, elle a donné
loyalement à tous ceux dont elle recevait l’or ce qu’ils réclamaient : le
suprême oubli dune heure dans l’enivrement d’un songe voluptueux. Et maintenant
tout son génie, tout son art, toute cette patiente méthode qui ont fait sa
fortune seraient perdus à jamais, s’évanouiraient comme la fumée d’une lampe ou
l’âme fugitive d’un parfum ? Non, ce n’est pas possible ! Phryné, la
soeur d’Aphrodite, se devait encore au difficile culte d’Éros ; elle
devait préparer pour lui d’autres servantes, d’autres prêtresses insignes ;
elle devait, de ses mains expertes, pétrir d’autres chairs délicates, blanches
cires qui se consumeraient goutte à goutte sur l’autel brûlant du dieu.
C’était, d’ailleurs, la coutume en Grèce et dans les colonies
ioniennes de l’Asie Mineure que les grandes courtisanes en formassent d’autres
à leur exemple. Dans les villes où se célébraient les mystères érotiques, le
temple même servait d’asile à ces écoles de jeunes hiérodules ; et
quelquefois, comme à Samos, comme à Amathonte, on les choisissait « parmi
les jeunes filles issues des meilleures familles et pour qui ce choix était un
honneur ». Mais ici, dans le
grouillement confus des moeurs d’Athènes, que la hautaine Pallas couvrait de
son égide indifférente, ce recrutement se faisait d’une façon moins officielle.
« L’art d’aimer » s’enseignait cependant ouvertement, sans qu’on eût
à en rougir. Toute une littérature spéciale existait sur cette matière
délicate, et l’on cite des traités nombreux parus bien avant celui de la
célèbre et impudique Éléphantis ; dont Suétone raconte que Tibère en avait
fait son livre de chevet.
« Ces professeurs féminins de volupté, nous dit M. Émile
Deschanel dans les
Courtisanes grecques, formaient leurs élèves
par tons les arts à l’art unique de l’amour ; par tous les procédés et les
raffinements imaginables, elles aiguisaient leur sensibilité... » Mais il est à croire que c’est la musique surtout qui était à la
base de cette éducation des jeunes courtisanes futures ; la musique,
source de toute eurythmie, poésie fluide, qui leur apprenait l’abandon des
attitudes et des gestes, la langueur des paroles tendrement murmurées, et cette
grâce souveraine qui règle la démarche des déesses lorsqu’elles foulent le sol
terrestre : Incessu patuit dea.
Ainsi Phryné, au milieu d’une théorie de jeunes vierges aux membres
lisses, se consolait de voir se creuser ses joues et s’appesantir ses seins.
Elle ne s’éprouvait pas jalouse de leurs charmes, et s’appliquait à leur
inculquer tous ses secrets. Cette théorie du mystère, qu’elle seule avait mise
en pratique, dont elle avait tiré son invincible attrait, elle la leur
enseignait en des phrases brèves et ardentes : « Cache ta beauté si
tu veux qu’on la recherche. – Plus tu es belle, plus tu dois t’envelopper
de voiles. – Découvre à peine ton sein, et ne laisse voir de ton visage
que ce qu’il faut pour allumer le désir. » Et son expérience, en faisant
retour sur le passé, lui suggérait que la curiosité est le ressort le plus
puissant de la passion, son essence même, son psychisme, et que la beauté, si
parfaite qu’elle soit, ne serait rien sans ce frémissement devant l’inconnu qui
est tout le tourment et tout l’intérêt de vivre.
Cependant Phryné, après avoir rempli ce pieux devoir, sent une
nostalgie lente envahir son âme. D’autres images, plus lointaines et plus
fraîches, la suavité de ses jours d’enfance, passent devant ses yeux – tel
le léger cortège des ombres, que colore un dernier rayon, traverse l’espace avant
eue la grande nuit ait tout recouvert de son manteau de silence. Elle songe à
la terre natale, pleine d’évocations et de murmures, où les fontaines chantent
sur les cailloux bleus, où les arbres, si mollement, sont balancés par le.
souffle des zéphyres. Combien cette Athènes de pierre et de marbre, où elle a
vécu si longtemps, lui paraît dure et froide, et l’Attique, « cette partie
desséchée du squelette du monde », selon le mot de Platon, comme elle lui
parait aride et désolée auprès du bois sacré des Muses et de l’Hélicon
mystérieux et touffu, au pied duquel était son berceau ! C’est là qu’elle
veut retourner ; elle veut revoir Thespies, et le temple antique de
l’Amour, et le coin de la route, ombragé d’un sycomore, où elle vendait ses
câpres aux passants.
Un soir, elle prend congé de ses amis, de ses jeunes compagnes. Sa
haute litière drapée de pourpre franchit la porte Dipyle, et l’emmène à travers
les rampes du Parnès. Elle s’exalte devant ces larges horizons, dont elle
reconnaît les lignes vaporeuses ; à mesure qu’elle avance, une émotion
plus vive l’étreint, une joie monte à ses lèvres. Il lui semble que sa beauté
va refleurir comme les asphodèles, comme les roses du chemin. Un instant, elle
se sent transfigurée. Quelque chose de très doux la pénètre. Elle n’a aucun
regret du passé, aucun désir vain pour l’avenir.
La voici dans Thespies. Elle a franchi le seuil du temple ;
elle a reconnu dans la pénombre l’adolescent admirable et doux qui incline sur
son épaule sa tête pensive, l’Éros que Praxitèle a sculpté et dont s’orne le
parvis sacré. Alors toute sa vie tressaille dans ses flancs usés ; elle
verse des larmes abondantes. Le souvenir du seul homme qu’elle ait aimé se mêle
à cette sainte extase, que l’Éros primitif, maître de la terre et des cieux,
suscite encore dans son âme.
Chaque jour elle retourne devant la divine image ; la
vieillesse maintenant incline vers la terre son front ; ses pieds la
portent à peine ; ses mains tremblantes s’érigent avec effort dans le
geste de l’adoration. Bientôt ce sera le dernier sommeil. Pourtant, elle ne
veut pas mourir sans avoir fait un don suprême à l’Amour. Elle détache sa
ceinture, les franges d’or qui se nouent à ses chevilles, et elle les suspend
au socle de la statue, avec le miroir d’argent poli, où tant de fois,
attentive, elle a vu se refléter le pur ovale de son visage, la clarté mouvante
de ses yeux, et l’ineffable sourire de sa bouche, pour laquelle tout un peuple
a pâli de désir. – « Ce miroir
d’argent, ces franges d’or, cette ceinture de lourds métaux, Phryné te les
offre, ô tendre Éros, pour te remercier des faveurs dont tu l’as
comblée ! »
Et maintenant la Thespienne peut clore ses lourdes paupières ;
l’apaisement est en elle, que donnent les dieux à ceux qui ont pleinement
accompli leur destin.
Il faudrait écrire, comme le fit jadis saint Basile, un traité « Aux jeunes gens, sur la manière de tirer profit des lettres helléniques », tant il est vrai qu’aujourd’hui nos pâles mœurs pâtissent du grave défaut d’un tel enseignement. On y lirait, par exemple, ce chapitre : L’illustre Praxitèle, athénien de naissance, fut un enfant bien élevé. Il apprit, chez le cithariste, àchanter sans serrer les jambes. Le pédotribe, à grands coups de baguette fourchue, lui enseigna comment étendre la cuisse afin de ne rien montrer d’indécent aux gens du dehors — ce spectacle lui étant réservé. Après l’exercice, on l’obligeait à égaliser le sable de façon à ne pas laisser aux amateurs l’empreinte de sa virilité. En ce temps-là, aucun enfant n’avait la permission de se frotter d’huile plus bas que le nombril, aussi leurs jeunes organes se couvraient-ils d’un duvet léger comme celui des coings. Aucun, la bouche en cœur, n’approchait son amant pour se donner à lui par le regard. Regrettons, comme Aristophane, les bonnes manières du bon vieux temps. Quand il fut en âge d’aller aux bains, il commença de s’exercer l’œil, suivant en cela le conseil de son père, Képhisodote, qui voulait faire de lui un artiste averti. Il y avait là tout un cénacle de musiciens et de poètes pour achever son éducation. Posidippe le Macédonien lui déclama son Hermaphrodite récemment composé. Xénarque le fit rire par son Priape promis au succès. Il lui fut bien difficile de ne pas applaudir au Paiderastes d’Antiphane, auquel Diphile, jaloux, répondit par son Paiderastai. Il lui prit l’envie de devenir célèbre à son tour. Il relèverait le défi de Platon. C’est à Mantinée, en Arcadie, que Praxitèle entailla son premier bloc de Paros. Il débutait dans cette contrée sous de bons auspices. Après avoir dégrossi quelques figures pour assurer l’habileté de sa main, il quitta cette cité, emportant à Athènes le souvenir impérissable du jeune satyre qu’il avait rencontré dans un bosquet arcadien. Il cisela un Satyre de pierre blanche et dorée, le plus beau qu’on ait jamais vu. Se tournant ensuite vers son âme, il lui demanda s’il avait bien travaillé. Elle lui répondit qu’il devait ce chef-d’œuvre à l’Amour et que l’Amour réclamait son dû. Le moment était venu de s’essayer aux grandes ambitions, il ferait le portrait de l’Amour pour faire honte à Homère de ne l’avoir dépeint. Il se promit la gloire. Se souvenant des gracieux chants d’Anacréon, Praxitèle courut à la palestre à la recherche d’Éros, car c’est là qu’on voyait passer les plus jolis dos de l’Attique. Un jeune Bathylle lui sourit et détourna pudiquement la tête. Il tenait son modèle : un Apollon dans la fleur de l’âge, celui-là même qu’avait chanté le poète de Téos, et qui avait, comme Cléobule, un doux regard de vierge… Il se mit aussitôt à l’ouvrage. Représente-moi Bathylle, mon jeune ami, tel que je vais te le décrire. Fais-lui des cheveux luisants, noirs en-dessous et à la surface dorés par le soleil. Réunis-les en boucles ondulantes et négligées que tu laisseras tomber en liberté… Fais-lui des joues de roses, couvertes, comme la pomme, d’un léger duvet… que son cou d’ivoire surpasse celui d’Adonis. Fais-lui la poitrine et les mains de Mercure, les cuisses de Pollux… au-dessus de ses cuisses délicates, de ses cuisses qui recèlent la flamme, montre-le, dans sa candeur pudique, sollicitant déjà la déesse de Paphos. Mais, hélas ! ton art jaloux ne te permettra pas de montrer le dos de mon jeune ami, et c’est ce qu’il a de plus beau… Ainsi naquit l’Éros de Praxitèle. L’art du sculpteur, moins jaloux que celui du peintre, le dota d’un revers qui ne le laissait en rien à l’avers. La déesse de Paphos ne fut cependant pas sollicitée ; l’artiste lui réservait d’autres chefs-d’œuvre. Dès lors, le bruit se répandit de l’Hellespont aux Colonnes qu’un merveilleux génie ailé honorait la Grèce hospitalière. En réalité, Éros n’honorait que la maison de Praxitèle ; celui-ci n’ayant jamais consenti à s’en séparer le gardait précieusement par-devers lui. Jusqu’au jour où… il sacrifia Éros à Aphrodite. Mais c’est une autre histoire. Il n’est personne, écrivait Varron, quelque peu d’instruction qu’il ait reçue, qui ne connaisse Praxitèle. On pourrait en dire autant de Phryné, la belle courtisane, la gloire des hétaïres de son siècle, le quatrième avant notre ère. Phryné, fille d’Epicléos, était thespienne de naissance, athénienne par vocation. Célèbre par sa richesse autant que par sa beauté, elle avait, vers la fin de sa carrière, assez de fortune pour offrir de relever à ses frais les murs de Thèbes qu’Alexandre avait mis à mal… « Alexandre les a détruits, Phryné seule les a rebâtis ». Si l’on admirait en Grèce la beauté superbe de cette fille, du moins ne s’en étonnait-on pas. En effet, nul ne pouvait ignorer que les enfants de Thespies étaient incomparablement beaux et vigoureux. Par quel miracle ? Était-ce parce que l’Amour y était honoré mieux que partout ailleurs ? Sans aucun doute. Depuis des temps immémoriaux, les habitants de la petite cité béotienne avaient élevé un temple à Éros Gonimos, auquel ils étaient redevables de leur nombreuse et belle progéniture. Le tailleur de pierre du Permessos avait réalisé l’antique effigie du dieu, une argos lithos, pierre brute d’allure fort suggestive qui fut plantée à l’entrée du ravin des Muses. C’est là-dessus qu’à l’occasion des Érotidies, tous les cinq ans , on faisait asseoir les jeune mariés, accourus de la Grèce entière pour avoir de beaux enfants. Personne alors n’aurait eu l’idée saugrenue d’installer des ailes sur l’étrange et vénérable représentation d’Éros fécond. Durant les fêtes tapageuses se déroulaient des jeux gymniques et des concours musicaux. Les pèlerins y trouvaient leur compte, car ces manifestations, souvent prolongées après le coucher du soleil, encourageaient la natalité. Enfin, on buvait à pleines coupes une eau sauvage qui avait, croyait-on, des vertus particulières. Mais ne serait-ce pas ici la clef de tous les mystères ? Dans son traité « Des plantes », Théophraste dit qu’il y a des lieux où l’eau fait faire des enfants (paidogonion) ; mais il n’en a trouvé qu’un seul exemple : Thespies . Phryné posa pour Praxitèle ; Praxitèle aima la beauté de Phryné. Ici commencent les tribulations de l’Éros en fleur. Le sculpteur avait une énorme dette envers son fastueux modèle ; car c’est elle, bien sûr, l’Aphrodite de Cnide ! De toutes les extrémités de la terre, on navigue vers Cnide pour y voir la statue de Vénus. Ce chef-d’œuvre fait la splendeur de leur ville. Pline fut transporté d’admiration. Lucien, de son côté, rapporte l’anecdote que personne n’ignore plus : Un jeune homme s’éprit autrefois pour cette statue… Un soir, au coucher du soleil, il se glissa derrière la porte du temple. Mais qui oserait vous dire clairement le crime de cette nuit impie ?… Phryné estima justement qu’une telle célébrité était due à ses mérites personnels. Elle exigea d’être payée en nature. Praxitèle ne put se dérober à ses désirs. Il lui offrit de choisir parmi ses plus beaux ouvrages, ceux qu’il gardait chez lui, le marbre qui conviendrait à ses délices. Il lui montra le Satyreillustre, et l’Apollon pubère chasseur de lézard ; il présenta Iacchos, l’enfant des mystères, et le Pan aux pieds de bouc ; et enfin, il découvrit à ses regards émerveillés le Pais Anteros, le génie ailé qu’on appelle l’Amour. Il est très tendre et comme rempli du désir de volupté… la rougeur de la vie semble colorer ses joues. Il montre un embonpoint délicat et la fraîcheur de son jeune corps… Ses yeux sont inondés de séduction et de grâce amoureuse. Phryné, comme Callistrate, se laissa séduire par les beaux yeux de l’Amour : Toutes les beautés qui embellissent l’Amour se retrouvent dans son image ; je reconnais ici le maître des dieux. Elle choisit sans plus hésiter ; elle demanda Éros pour venger Aphrodite que Praxitèle avait été le premier à représenter sans voiles. Celui-ci, prenant son ciseau, rendit un dernier hommage à son préféré ; il inscrivit cet émouvant message : Praxitèle a représenté fidèlement l’amour dont il a souffert. Il en a tiré le modèle de son propre cœur. — Il m’a donné à Phryné pour prix de moi-même ; si je lance des philtres, ce n’est plus à coups de flèches, c’est par la fixité de mon regard. Phryné, donc, emporta Éros. Mais ce fut pour le donner à Thespies. Fille pieuse et généreuse, elle n’avait pas oublié le jardin de ses enfances, le ravin des Muses ni le curieux bloc de pierre que toute jeunette encore elle s’amusait à enlacer de ses bras. Et puis, elle devait tant à Éros… L’enfant aux ailes d’or devint le dieu tutélaire des Thespiens à la place de l’antique Gonimos. Il avait fière allure, on était fier de lui. C’est à lui désormais que furent présentés les jeunes gens venus des quatre coins de la Grèce pour l’honorer. Sa réputation grandit de jour en jour, traversa les mers et les siècles, tant il sut convaincre ses visiteurs de son charme envoûtant. Il n’est pas un sculpteur qui ne soit venu s’inspirer de ses formes parfaites, pas un poète qui n’ait composé pour lui au moins une épigramme, pas un musicien qui ne l’ait évoqué sur sa lyre. Si on l’aima en discours, en chansons et en pensées on l’aima aussi… en actes, à tour de bras ! Par quelle ironie du destin connut-il le sortilège qu’on aurait cru réservé à la Vénus de Cnide ? On ne saurait le dire. Pourtant, à l’évidence, leurs sorts était liés. Si l’on en croit Athénée, il subit plusieurs fois cet assaut inouï qui était encore, malgré sa démence, un étrange hommage rendu à sa beauté . Thespies n’est plus rien, dit Cicéron, mais elle conserve l’Éros de Praxitèle, et il n’est aucun voyageur qui n’aille la visiter pour connaître cette belle statue. On ne peut s’étonner du succès extraordinaire du jeune dieu de Thespies. Qui donc, mieux que les Grecs, s’y connaissait en beauté et en science amoureuse ? Ô Grecs ! qui consacrez dans vos maisons les statues de vos dieux comme des colonnes d’impureté , vous ne fîtes jamais de colonne aussi pure que celle-ci… L’Éros de Thespies vécut en Béotie jusqu’à la fin de l’ère ancienne. Caligula devenu empereur se l’appropria, et le fit venir à Rome. Claude, bon prince, le rendit aux Thespiens. Néron le reprit et le plaça au portique d’Octavie. C’est là qu’il fut détruit par le feu, à peu près à l’époque où disparurent aussi Herculanum et Pompéi. Heureusement, Ménodore d’Athènes en avait fait une copie fidèle. Elle arriva, on ne sait trop comment, à Messine, dans la villa d’un riche amateur, Héius. Verrès en fit sa proie pour seize cents sesterces, la mit à l’honneur dans sa collection. De là, nous perdons sa trace ; mais ne pouvons-nous pas nous irriter, avec Cicéron, de l’injure qui lui fut faite ?… « Héius avait un très bel oratoire, monument antique de la piété de ses ancêtres. On y voyait quatre statues célèbres, toutes d’un travail exquis et faites pour charmer non seulement un connaisseur et un homme d’esprit tel que Verrès, mais nous autres ignorants, comme il nous appelle… L’une des quatre était un Cupidon de marbre, ouvrage de Praxitèle… Claudius, étant édile, emprunta ce Cupidon pour orner le forum dans une fête qu’il donnait au peuple romain. Il s’empressa ensuite de le rendre à Héius et à Messine dont il était l’hôte et le protecteur. Eh quoi ! lorsque Claudius Pulcher a fidèlement restitué ce trésor, c’était donc pour que Verrès sautât dessus ? Mais ce Cupidon ne cherchait pas une maison de débauche, une école de prostitution ! Il ne demandait pas à passer chez l’héritier d’une courtisane !… » Éros disparu, on se consola de sa perte avec son petit frère de Parion — également de la main de Praxitèle — connu au Louvre sous le nom de Génie Borghèse. Dans ce même temple se trouve aussi l’Éros Farnèse, jeune complice de notre ami, qui aurait bien son mot à dire dans cette longue histoire. Bref, on se consola comme on put, jusqu’au jour où un fameux coup de pioche donné à Centocelle sur l’emplacement des jardins d’Héliogabale, non loin de Saint-Jean-de-Latran, ramena au soleil celui qu’on attendait depuis dix-huit siècles. Visconti, aussitôt, reconnut son visage céleste. Éros entra au Vatican…